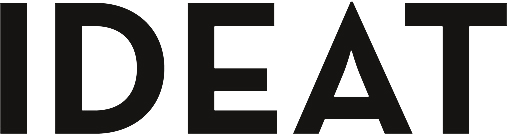Les dernières biennales de Saint-Étienne seraient plutôt devenues triennales si l’on en juge l’intervalle entre les éditions : 2019, 2022, 2025… Qu’à cela ne tienne, les ambitions de cette 13e édition étaient grandes, avec la présentation de productions de 275 designers. Surtout, l’événement réaffirmait le rôle majeur de l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) comme pivot d’une réflexion sur les pratiques du design, qui ne doivent pas céder aux tentations du marché.
À regarder aussi : VIDEO : retour sur la 12e biennale internationale design de Saint-Etienne
Le plein de ressources
En 1998, le directeur de l’établissement, Jacques Bonnaval, avait eu la géniale idée de créer ce festival, alors unique dans l’Hexagone. Et, tandis que le design s’attachait avant tout à des critères esthétiques, il s’affichait à Saint-Étienne avec un sens plus profond, en abordant la notion de projet derrière l’objet – en accord avec la pensée et les enjeux de l’époque.

Presque trois décennies plus tard, le duo formé par le designer Éric Jourdan, directeur de la Cité du design (et, par extension, de l’Esadse), et la curatrice et enseignante en design Laurence Salmon, a poursuivi cette mission et posé comme thème fédérateur la question, de plus en plus présente, des ressources dans notre quotidien (matérielles, énergétiques, mais aussi humaines).
« Le terme est riche de sens et d’interprétation, d’autant plus dans le contexte de l’héritage minier et manufacturier de Saint-Étienne », soulignait Laurence Salmon, qui assurait le commissariat général de l’exposition phare de cette édition, intitulée « Ressource(s), présager demain », déployée dans les Halles Barrouin, à proximité de la Cité du design.

La discipline y était affichée comme une ressource à part entière, de taille à affronter au mieux les changements et les mutations de la société actuelle. « Le designer est en capacité, par sa créativité, sa culture du projet, sa gestion des contraintes, sa démarche responsable, de dessiner des mondes nouveaux, d’envisager des améliorations ou des adaptations qui prennent en compte les exigences et les enjeux sociétaux », précisait-elle.
Au travers de neuf sections distinctes, réfléchies par autant de designers ou d’architectes curateurs invités (Frédéric Beuvry, Isabelle Daëron, Sylvia Fredriksson, Marlène Huissoud, Laurent Massaloux, Étienne Mineur, Natacha Poutoux, Philippe Rahm et Anna Saint Pierre) et scénographiées par Joachim Jirou-Najou, l’accrochage rassemblait objets et projets venant étayer des thèmes tels que « Design climatique », « Déjà là », « Terres promises », « Le devenir industriel », ou encore « Créer avec l’IA ».

Sous la même halle, presque comme une mise en situation très pragmatique, un second accrochage, intitulé « Design des territoires », rendait compte d’initiatives menées par des jeunes designers fraîchement diplômés qui se sont impliqués dans des milieux (ruraux, forestiers, insulaires…) en vue de retisser des liens avec un existant souvent délaissé ou oublié.
Design raisonné et raisonnable
De retour vers la Cité du design, trois autres expositions venaient poursuivre la réflexion sur ce que peut être une ressource : « Le droit de rêver » exposait les travaux d’étudiants de l’Esadse sur ce besoin quasi obligatoire de laisser aller sa créativité, « En relief » mettait l’accent sur la création en Arménie – dont peu de travaux ont jusqu’alors été montrés en France, enfin, « Qui êtes-vous Raymond Guidot ? », composée à partir d’archives de cette figure du design par Nestor Perkal, rendait hommage à celui qui fut à la fois ingénieur, artiste, designer, enseignant, commissaire d’exposition… peu connu du grand public, mais qui a joué un rôle clé dans la réflexion portée sur le design à partir des années 1960.

Au total, la biennale résonnait à travers plus d’une vingtaine d’expositions et d’événements répartis dans toute l’agglomération stéphanoise. On peut seulement regretter que l’édition n’ait duré que trop peu de temps (six semaines), pour porter cette bonne parole d’un design raisonné et raisonnable.
Heureusement, la Cité du design demeure active toute l’année et continue à jouer ce rôle de relais. Elle devrait encore monter en puissance avec l’ouverture, en juin dernier, de la Galerie nationale du design, qui s’affiche comme le premier lieu d’exposition permanente consacré à la valorisation de toutes les collections françaises de design dans l’Hexagone.
À lire aussi : La 8e Biennale Émergences rend hommage aux métiers d’art



 La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
 Terrass’ Hôtel
Terrass’ Hôtel
 Sifas
Sifas
 Ehia
Ehia
 Le Four à Chaux
Le Four à Chaux
 Ethimo
Ethimo
 Les Sources de Caudalie
Les Sources de Caudalie
 La Grande Maison
La Grande Maison
 La Course
La Course
 Hôtel de Tourny
Hôtel de Tourny
 Une Cuisine en ville
Une Cuisine en ville
 Côté rue
Côté rue