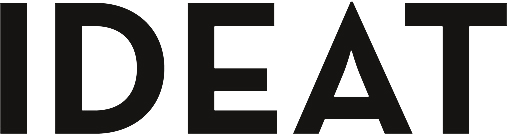La Française Dominique Jakob et le Néo-Zélandais Brendan MacFarlane sont les co-commissaires du Pavillon français de la prochaine Biennale d’architecture de Venise, intitulée « Intelligens. Natural. Artificial. Collective. », qui se tiendra du 10 mai au 23 novembre prochains. Ils nous ont accueillis dans leur agence parisienne, fondée en 1998. L’occasion d’échanger autour de leur métier dans un monde en plein bouleversement et de la nécessité de « Vivre avec/Living With », le titre de l’exposition qu’ils présenteront dans les giardini vénitiens.
À lire aussi : La Maison connectée de Jakob + MacFarlane
Faire face aux défis climatiques
IDEAT : Commissaire général de la prochaine Biennale d’architecture de Venise, Carlo Ratti a déclaré : « L’architecture doit devenir aussi flexible et dynamique que le monde pour lequel nous concevons aujourd’hui. » De quelle façon votre proposition pour le Pavillon français y fait-elle écho ?
Jakob+MacFarlane : L’instabilité est une thématique qui nous a toujours intéressés. En 2008, sous la direction de l’architecte Aaron Betsky, nous avions présenté à Venise l’installation Conflicts, un prototype d’espace évolutif pour le XXIe siècle à partir d’algorithmes et des perturbations des cours de la Bourse (blé, pétrole, matières premières…). En 2013, nous avons réalisé le Fonds régional d’art contemporain Centre Pays-de-Loire, à Orléans, qui s’appelle Les Turbulences. « Instabilité », notre titre initial pour l’exposition du Pavillon français, est devenu « Vivre avec », que nous avons trouvé plus constructif.

Nous sommes très heureux que notre proposition ait été retenue pour cette 19e édition. Elle interroge la capacité de l’architecture à faire face aux défis climatiques, aux conflits et à l’instabilité du monde. Pour cela, l’exposition explore six thématiques : vivre avec l’existant, les proximités, l’abîmé, les vulnérabilités, la nature et le vivant, les intelligences. La question que nous posons est la suivante : comment continuer à habiter sur cette planète en inventant, face à ces défis, de nouveaux modes de vie ?
IDEAT : Faire avec la contrainte, c’est ce que vous allez concrètement explorer à Venise, puisque le Pavillon français est fermé pour travaux en 2025. Comment avez-vous abordé cette donnée ?
L’alternative aurait été de s’installer ailleurs, dans un autre lieu à Venise. Tout était ouvert. Certains ont imaginé aller sur des îles, d’autres sur des bateaux. De notre côté, nous avons préféré rester sur place et investir les abords extérieurs du Pavillon français avec une structure éphémère. Le chantier de restauration fait ainsi partie intégrante de notre projet curatorial. Généralement ignoré, le sous-bois qui jouxte le pavillon participe pleinement à l’expérience architecturale, sensorielle et scénographique que nous proposons.

« Vivre avec/Living With » se tourne également vers le canal situé juste derrière, car l’eau est un élément majeur du paysage et de l’infrastructure vénitiens. La fermeture du pavillon offre ainsi l’opportunité d’une collaboration entre l’architecture et la nature. Dans cette idée de prendre soin, de travailler avec l’existant et l’instabilité, pourquoi s’installer ailleurs ? Tout faisait sens.
IDEAT : Quelle scénographie avez-vous imaginée pour exposer à l’extérieur ?
Le Pavillon français étant échafaudé pendant toute la durée des travaux, nous avons décidé de prolonger cette logique pour ne former qu’un seul et même système – également dans une démarche zero waste (« zéro gâchis »), puisque l’échafaudage est loué le temps de la manifestation. La totalité des éléments de ce pavillon éphémère est réemployable. Une bâche de chantier protège le site en cas de pluie, et des filets de protection font office de garde-corps : nous utilisons uniquement du matériel de chantier.

La seule chose que nous ajoutons, ce sont des panneaux de bois vissés sur la structure sur lesquels sont sérigraphiés, à l’encre biologique, les projets que nous présentons dans le pavillon. L’intention scénographique vise à créer une cohérence entre la structure et le contexte, l’objectif étant d’offrir une expérience à la fois chargée d’émotion et propice à la réflexion, où l’une ne peut pas délivrer son message sans l’autre.
IDEAT : De quelle façon avez-vous procédé pour sélectionner les projets qui seront présentés dans le Pavillon français ?
Avec Martin Duplantier et Éric Daniel-Lacombe, co-commissaires, nous avons lancé un appel à projets international, pour rassembler des propositions conçues pour s’adapter à l’un ou plusieurs des défis engendrés par les perturbations climatiques, les conflits et les instabilités. Nous en avons retenues 41 parmi les 275 que nous avons reçues. Les réponses architecturales mises en avant représentent une rupture dans notre manière de comprendre et d’appréhender, et même de réinventer, les défis contemporains.

Bien que ces projets illustrent une grande ingéniosité et différentes possibles transformations dans un monde instable et en constante évolution, ils ne sont que le début d’un changement urgent à l’échelle planétaire. Les créations de « Vivre avec/Living With » mettent en lumière la puissance des intelligences réunies – humaine, naturelle et technologique – qui nous accompagnent dans l’incertitude. Le résultat : une architecture profondément liée au monde que nous habitons, afin qu’il demeure habitable.
IDEAT : Pouvez-vous nous dévoiler quelques exemples ?
Nous y verrons le formidable travail que mène Salima Naji, architecte et anthropologue, au Maroc. Elle défend l’écoconstruction face aux défis d’une certaine modernité et montre la résilience des architectures oasiennes. Son complexe pédagogique de Timenkar, dans le Haut Atlas, est un projet parasismique associant bois et pierre pour faire face à l’instabilité du climat et anticiper les prochains séismes.

Au Bangladesh, Kashef Chowdhury conçoit des villages surélevés qui permettent de construire en zone inondable. Nous présenterons également Home For All, projet lancé par Toyo Ito avec un groupe d’architectes pour répondre aux besoins de logements d’urgence après le tsunami en 2011 au Japon et explorer les typologies futures possibles des villes côtières exposées à ce risque. Il y aura aussi la Rambla Climate-House, d’Andrés Jaque, à Murcie, en Espagne, une maison qui fonctionne comme un dispositif climatique et écologique très poussé, ou encore le Tom Lee Park, de Studio Gang, à Memphis, dans le Tennessee (États-Unis).
Face au Mississippi, ce parc catalyse la réunification de la ville et de son fleuve, dont les rives furent longtemps confisquées par l’activité industrielle. La moitié des projets vient du monde entier. Il y a également des travaux français, comme Le Potager extraordinaire, de l’agence Guinée Potin, à la Roche-sur-Yon, ou La Plaine du Maharin, de Thibaud Babled, à Anglet. La sélection fut difficile, il existe beaucoup d’initiatives très intéressantes.
Une exposition qui a vocation à voyager
IDEAT : Pour celles et ceux qui n’auront pas l’opportunité d’aller à Venise, l’exposition partira en itinérance après la manifestation…
Oui, et elle débutera à Orléans en 2026, aux Turbulences. L’exposition « Vivre avec/Living with » y sera présentée dans une version augmentée, avec notamment une place plus importante accordée aux écoles d’architecture qui travaillent sur ces sujets.
IDEAT : Il n’y a pas que Venise dans votre actualité chargée ! Parmi vos projets en cours figure également le Fonds régional d’art contemporain-Artothèque Nouvelle-Aquitaine, à Limoges…
Il rouvrira ses portes le 20 mai dans un nouveau lieu situé dans le centre historique de Limoges. Il réunit les collections du FRAC et celle de l’Artothèque dans une ancienne imprimerie du début du XXe siècle que nous avons transformée. Le principal défi consistait à mettre en valeur un bâtiment historique tout en créant un cadre propice pour accueillir des œuvres contemporaines. S’il fallait faire preuve de retenue, voire d’humilité, il ne fallait pas non plus laisser l’histoire prendre le pas. Nous sommes revenus à la structure originelle du bâtiment pour la faire évoluer par plusieurs interventions légères.

À l’intérieur, nous avons construit une « boîte immersive », un espace multimédia sur mesure qui accueille des œuvres digitales, spécificité des collections. Elle peut être entièrement fermée, partiellement s’ouvrir pour fusionner avec le reste du lieu, ou encore complètement ouverte. Sur la rue, une façade connectée crée une membrane lumineuse entre l’intérieur et l’extérieur et permet à l’art d’investir l’espace public.
IDEAT : Comme dans nombre de vos projets, vous vous êtes attachés à préserver l’identité industrielle du lieu et à en affirmer la dimension publique. Quelle était la stratégie ?
À Limoges, nous avons milité pour garder le maximum d’éléments déjà présents sur place, comme les magnifiques carreaux de grès au sol. Ce qui fut une petite bataille. On a conservé tout ce qui pouvait l’être : les garde-corps, des parties de façade de l’ancienne imprimerie, pour garder l’esprit du lieu.

Nous travaillons toujours une distinction assez claire entre ce qui était là et ce qu’on a rajouté, pour qu’il n’y ait pas de confusion dans la lecture de l’endroit. Nous avons également réalisé le mobilier du café-lecture, en bois et en cuir, grâce à un mécénat, avec des chutes du chausseur J.M. Weston. L’installation de ce café était prévue pour le premier étage et l’artothèque, pour le rez-de-chaussée. Lors du concours, nous avons proposé d’inverser. Le café, c’est l’interface entre le bâtiment et l’espace public : il avait toute sa place au rez-de-chaussée.
IDEAT : Aujourd’hui incontournable, la transformation de l’existant est une question que vous avez abordée très tôt…
C’est un sujet qui traverse toute notre pratique depuis longtemps. En 2012, nous avons livré Les Docks Cité de la Mode et du Design sur la Seine. Issu de la transformation des anciens magasins généraux d’Austerlitz, le bâtiment, avec sa couleur vert vif et sa position au cœur de la ville, est aujourd’hui un repère incontournable à Paris.

À Avignon, nous venons de terminer la restructuration de la médiathèque Renaud-Barrault, réalisée en 1985 par Béatrice Douine et Jacques Prunis. Sa rénovation s’inscrit dans le cadre du renouvellement urbain du quartier où elle se trouve.
IDEAT : Quelle attitude avez-vous déployée sur cette architecture des années 1980 ?
La canopée en bois qui forme le nouveau toit est la métaphore-clé de la rénovation de la bibliothèque. L’arbre symbolise l’ombre et la protection – un espace où l’on peut faire une pause, se plonger dans un livre ou partager des connaissances avec d’autres. L’escalier central, dont les murs sont habillés d’étagères, évoque le tronc, tandis que cette nouvelle toiture solaire fournit à la fois de l’ombre et de l’énergie.

L’ensoleillement abondant de la région a en effet naturellement inspiré son utilisation pour capter l’énergie solaire, conformément à l’amélioration environnementale de la conception originale des années 1980. Dans le cadre de cette transformation, tous les éléments non structurels ont été retirés, afin de magnifier le volume de béton existant et de souligner son réemploi dans le nouveau projet. L’isolation thermique a été appliquée à l’intérieur, préservant l’intégrité matérielle de l’extérieur. La bibliothèque a rouvert en novembre dernier.
IDEAT : Vous travaillez également sur le nouveau campus de l’Université française d’Égypte, au Caire. Pouvez-vous nous en parler ?
Le concours a eu lieu pendant la crise du Covid-19. C’est un ensemble assez important : quatorze bâtiments, 32 000 m², et un vaste programme qui rassemble des édifices dévolus aux études et à la recherche, un learning center, un auditorium, des logements étudiants, des équipements sportifs et récréatifs, des services de restauration et l’immeuble administratif de l’université. Nous avons imaginé une grande ombrière pour unifier l’ensemble et, surtout, pour se protéger des rayons du soleil.

La difficulté principale, c’est la chaleur. Nous avons essayé de ventiler naturellement au maximum et de limiter au mieux tous les dispositifs qui font appel à la climatisation. L’ombrière protège les cheminements et les espaces publics, mais aussi les bâtiments. Des jardins encaissés participent au microclimat que nous cherchons à créer. Nous nous sommes inspirés de l’architecture traditionnelle des souks. Nous utilisons la pierre locale traditionnelle, la hashma, qui est magnifique, ainsi que la terre crue, dans les circulations. Le chantier vient de commencer.
IDEAT : Vous avez finalement peu construit en béton, matériau qui suscite aujourd’hui beaucoup de défiance…
Nous avons privilégié les structures légères, comme le métal. Au départ, c’était vraiment un frein de ne pas construire avec ce matériau. Dans les années 2000, les lobbies étaient très puissants. Nous avons toujours résisté au maximum pour faire autrement dès que c’était possible.
IDEAT : Ce qui est assez rare parmi les architectes de votre génération !
On se sent encore jeunes professionnels, on a encore envie de réaliser plein de bâtiments ! Il est devenu compliqué d’être architecte, la période est incroyablement difficile pour la profession mais également passionnante. Ce qui est intéressant, c’est que nous n’avons plus d’autre choix que de nous adapter, d’innover. Ce qui nous permet de parler plus facilement et à un plus grand nombre des sujets qui nous préoccupent.

Notre métier est plein de contradictions, mais le moment que nous vivons collectivement est excitant malgré les problèmes économiques. Pour nous, l’époque est plus riche intellectuellement, dans les échanges, dans les attendus, même dans les sujets qu’on nous demande de traiter, comme celui des performances environnementales. Auparavant, on nous demandait un prix, une forme et une image. C’est terminé. Les conditions de travail et les défis sont bien plus stimulants. Et obligent à se remettre constamment en question. C’est ce que nous essaierons de montrer dans la Biennale d’architecture de Venise.
À lire aussi : La micro-architecture, terrain d’apprentissage et de maîtrise