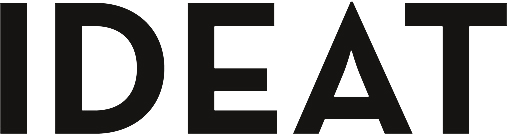« Il serait impossible pour moi de concevoir une chaise en plastique, en métal ou en contreplaqué. Je n’ai pas cet état d’esprit. J’ai plutôt l’impression de produire du mobilier de qualité dans lequel survit l’esprit d’un arbre auquel je donne en quelque sorte une seconde destination. C’est cela que je recherche : nouer une relation avec un arbre. Je suis même très heureux de faire ça », expliquait George Nakashima (1905-1990), dans une interview à écouter sur le site Nakashima Woodworkers.
À lire aussi : Ode à la Nature, Tai Ping invite la poésie de George Nakashima
Domaine expérimental
L’histoire de l’ébéniste et architecte, né aux États-Unis dans une famille japonaise, est d’abord liée à un lieu : la ferme de New Hope, un petit village de Pennsylvanie, sur la côte est américaine. De la fin des années 1940 au milieu des années 1970, il a vécu et travaillé ici, au début avec son mentor, l’architecte américain Antonin Raymond, ancien collaborateur de Frank Lloyd Wright (notamment sur la construction de l’Hôtel impérial de Tokyo).

Les deux architectes se sont rencontrés lors du tour du monde en bateau qu’effectue George Nakashima dans les années 1930. Au cours de ce périple, il fait aussi la connaissance de sa femme, Marion Okajima, au Japon, et de Le Corbusier, en France, avec qui il échange sur la vocation sociale du design.
De 1937 à 1940, il supervise le chantier du dortoir de l’ashram de Golconde, conçu par Antonin Raymond à Pondichéry, en Inde. C’est à ce moment-là qu’il commence à fabriquer ses premiers meubles.

Mais alors qu’il est de retour aux États-Unis depuis un an, a lieu l’attaque japonaise de Pearl Harbor. À l’instar de nombreux Américains d’origine japonaise, le couple Nakashima est interné au camp de Minidoka, dans l’Idaho. George réussit néanmoins à y travailler avec le maître charpentier japonais Gentaro Hikogawa (1902-1963).
En 1943, Antonin Raymond et son épouse Noémi parviennent à faire libérer George et Marion. Les Raymond, propriétaires d’une ferme à New Hope, proposent alors à George de l’embaucher comme ouvrier agricole. Ce dernier accepte et trouve aussi le temps de concevoir et de fabriquer des meubles.

Au début, le couple Nakashima occupe un simple cottage avec un petit terrain dans les environs. Le garage est transformé en atelier de fabrication de mobilier (c’est d’ailleurs à ce moment-là qu’une rencontre de George Nakashima avec l’éditeur Hans Knoll aboutit à l’édition d’une collection de chaises en bois).
Et c’est ici que George commence à imaginer et à bâtir un domaine, qui s’est agrandi au fil des ans, pour finir par accueillir 21 bâtiments – parmi lesquels une salle d’exposition, des ateliers, mais aussi la maison familiale des Nakashima et de leurs deux enfants, achevée vers 1947, et le Conoid Studio, en 1959.

À la fois atelier, résidence et showroom, c’est l’un des édifices les plus grands et les plus audacieux de cet ensemble. Le domaine a atteint sa forme définitive dans les années 1970, lorsque se sont ajoutés une maison d’accueil, un cloître, un « bâtiment des arts » et une pool house. Aujourd’hui, le site où vit et travaille Mira, la fille des Nakashima, se visite sur rendez-vous.
Toit sculptural
La construction du Conoid Studio est l’occasion pour Nakashima d’explorer son intérêt pour les structures en forme de coquille, s’inspirant pour cette maison-atelier du travail de Félix Candela, architecte mexicain pionnier en la matière.

Le Conoid Studio est coiffé d’un toit de béton scellé, à l’intérieur comme à l’extérieur, par des revêtements protecteurs. Sous cet élément sculptural, le studio est éclairé par une large rangée de fenêtres donnant sur les arbres. Les planchers en bois, les fenêtres et les lanternes en papier d’Isamu Noguchi confèrent à l’espace une impression de nature, qui vient dialoguer avec le toit en béton.
L’endroit est idéal pour exposer le mobilier de George. Le designer américain Harry Bertoia, sculpteur à l’origine, étant un ami de la famille, on peut y admirer plusieurs de ses sculptures. Un bureau, une kitchenette et une petite salle de bains ont été placés à l’arrière.

En 1975, deux ans après que Nelson Rockefeller, gouverneur de l’État de New York, lui a commandé 200 chaises pour sa maison, George Nakashima termine la guesthouse – une résidence indépendante à côté de chez lui. Elle a également été conçue avec un mélange d’influences japonaises et américaines, au diapason d’une approche prenant toujours en compte le contexte environnemental du site.
Ce pavillon d’hôtes comprend un espace de vie qui fait à la fois office de salon, de chambre à coucher et de salle à manger, tandis qu’une cuisine est soigneusement dissimulée derrière une cloison coulissante. Une « chambre japonaise » avec des tatamis est destinée aussi bien à la contemplation qu’au repos.

Dans la grande salle de bains, la baignoire est sculpturale. Elle est recouverte de mosaïque, et les noms des enfants et des petits-enfants de Nakashima y ont été inscrits. Actuellement, c’est Mira, elle-même architecte et designer, qui, avec son frère, dirige le George Nakashima Woodworkers, un atelier d’une douzaine d’artisans. Elle a collaboré avec son père sur certains projets avant sa disparition, en 1990, et témoigne :
« J’ai une affection particulière pour le Conoid Studio. Parfois, quand j’y travaille tard, je peux regarder le soleil se coucher à travers le mur de verre. Cette impression de voir tout ce qui se passe à l’extérieur, très présente dans l’architecture japonaise traditionnelle, est quelque chose d’incroyable. »
À lire aussi : Portrait : George Nakashima, designer au service du bois



 ACE HOTEL
ACE HOTEL
 Made Hotel
Made Hotel
 Public Hotel
Public Hotel
 The Whitby Hotel
The Whitby Hotel
 New Mission Theater
New Mission Theater
 Creativity Explored
Creativity Explored
 Galería de la Raza
Galería de la Raza
 Needles and Pens
Needles and Pens
 Bi-Rite Creamery
Bi-Rite Creamery
 Intercontinental
Intercontinental
 Foreign Cinema
Foreign Cinema
 Philz Coffee
Philz Coffee