En 1994, vous fondez votre studio, de quoi rêviez-vous ?
Ludovica : Je ne savais pas ce que je voulais faire, mais j’étais sûre de vouloir créer mes propres instruments pour m’exprimer. Un créatif, c’est un contagieux qui contamine les gens pour imposer son point de vue. Il lui faut user de tous les instruments possibles. C’était ça mon état d’esprit au départ.
Roberto : Au début, on attend. Nous voulions raconter une histoire différente du postmodernisme. Nous étions curieux, pas agressifs. Nous avons été chanceux. Maintenant, nous avons l’embarras du choix. Mais nous ne sommes pas boulimiques. On aime faire les choses bien.

Qu’est-ce qui a le plus changé dans le design depuis vos débuts ?
R. : Il y avait les maestri, comme Magistretti et Castiglioni, des antistars au service des gens. Puis la forme a primé sur la fonction et la communication sur la substance. Ma génération est aujourd’hui partagée entre l’émotionnel et le rationnel. Il nous faut nous amuser à être sérieux. Pour avoir une raison d’être pour l’éternité, comme le sac Kelly d’Hermès. J’ai commencé avec une table à dessin achetée par mon père. L’usine qui la produisait a disparu cinq ans après. Aujourd’hui, tout ce qui n’attire plus de like sur Instagram disparaît illico.
L. : Plus rien n’est comme avant. Le design est désormais fait pour les gens qui l’achètent alors qu’il était davantage par le passé une façon pour le designer de s’exprimer à travers un objet. En même temps, le design, ce n’est pas de l’art. Ce que nous faisons est produit pour des milliers de personnes. Et ce public a changé.

Ex-rois de la salle de bains, que ressentiez-vous à l’époque ?
L. : Les gens ignoraient que nous faisions aussi autre chose. Nous avons eu beaucoup d’opportunités dans la salle de bains. C’était fantastique, mais ce n’était qu’un moment.
R. : Et une malédiction ! (Rires) Nous avons aussi fait de superbes lampes avec Foscarini, des vases en verre de Murano traité comme du papier japonais, de très belles chaises et des radiateurs. Autant de choses poétiques, mais on ne nous parlait que de salle de bains à cause de nos innovations…
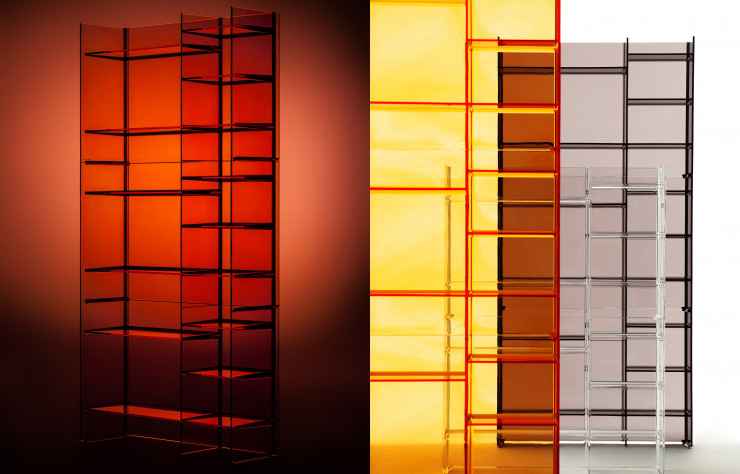
Les éditeurs de salles de bains vous ont-ils encouragés ?
L. : Oui, beaucoup. Tout était à faire. On nous regardait un peu comme des Martiens, mais ça a marché parce qu’on a trouvé des entreprises aussi folles que nous.
R. : Au début, les gens trouvaient le lavabo carré idiot. À l’usine Flaminia, il a été qualifié d’« auge à cochons ». Et le siège des toilettes, de « crachoir ». Et les commerciaux ne comprenaient pas ces produits. Moi, je regardais en avant, eux analysaient l’instant présent. Cela dit, ils nous renseignaient sur le marché. Les ignorer eût été arrogant. Mais leur obéir, non !
Êtes-vous sortis de cette assignation ?
R. : Nous travaillons un peu moins pour la salle de bains. Je n’y vois d’ailleurs que peu d’innovations.
L. : On a fait de tout à contre-courant. Le marché a été très bienveillant. Nous avons décrypté le mode de vie contemporain autour de ces produits. C’est comme ça qu’on se rapproche de ce que la société peut vouloir. Les produits ne la reflètent pas, ils anticipent son désir.

Vous inspirez-vous du passé ?
L. : Non. Le passé, la vie des autres, chacun en a quelque chose en soi. L’inspiration reste donc très intime.
R. : Avant, j’achetais beaucoup de magazines. Aujourd’hui, je fais des recherches sur Pinterest. Je regarde dans quel type de mode de vie mon futur canapé doit prendre place plutôt que de regarder ceux des autres.
Travailler à deux, c’est comment ?
L. : C’est merveilleux, très beau mais… terrible (rires). Comme la vie ! Un jour, c’est parfait, le lendemain, horrible. Travailler avec Roberto, c’est une façon de vivre, sans règles.
R. : On a toujours fait comme ça. Nos avis divergent plus à la maison qu’au travail. Tous les matins, je me demande pourquoi je travaille avec Ludovica. Et tous les soirs, je me dis que je suis très content. Je le vis, c’est tout. Je ne peux pas travailler seul !

Endossez-vous toujours le même rôle dans chaque projet ?
L. : Non, non. Rien n’est jamais pareil. Nous n’avons pas de territoire. Nous sommes très libres. Cela ne va pas sans devoirs. Mais on évolue sans se sentir en cage.
R. : On a une grande confiance réciproque. Mais je suis plus impatient. J’aime le design parce que ça va vite. Mais Ludovica aime l’architecture parce qu’on y prend le temps.

Ludovica la Romaine et Roberto le Sarde, êtes-vous devenus milanais ?
L. : Non. J’aime beaucoup Milan, c’est une ville fantastique, mais je me sens surtout citoyenne du monde. Je l’ai fortement ressenti cet été, au Japon.
R. : Milan est une ville confortable qui m’a beaucoup donné et beaucoup pris. C’est un monde de compétition qui peut être stupide. Chacun y vit en cachant son travail. La ville du Salone del Mobile est froide et plus provinciale qu’intellectuelle. Le design y est resté proche de l’artisanat, à part peut-être chez Kartell. Beaucoup d’usines appartiennent à des fonds d’investissement. L’ensemble ne produit à l’échelle planétaire que pour une grappe de privilégiés. Il ne faut pas l’oublier, avant que le marché ne déménage à Shanghai. Désolé, je ne suis pas politiquement correct.



