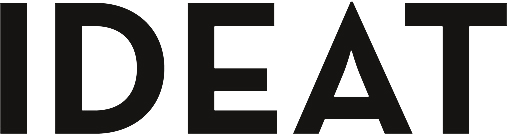Après des années de grands gestes spectaculaires, la figure de la micro-architecture est revenue avec force. Fragilisés économiquement, les bâtiments ambitieux trop coûteux apparaissent anachroniques face aux enjeux dictés par la crise environnementale. Ainsi, nombreux sont les architectes qui se reconnectent avec l’acte de construire.
À lire aussi : Maison solaire à Montfort-l’Amaury : le cocon minéral de Francesco Balzano
Points de départ
La petite échelle fait désormais figure de graal pour maîtriser une construction dans ses moindres détails, mais aussi pour renouer avec les savoir-faire locaux, à l’image de plusieurs réalisations présentées dans ces pages. La designeuse Constance Guisset s’est prise au jeu : « La grande différence tenait à la technique de la pierre et au fait de créer un bâtiment dans son entièreté. Suchaillou m’a poussée dans mes retranchements, j’ai aimé le frisson et le doute qui m’ont animée pendant tout le projet. Nul doute qu’il gardera une place particulière dans ma carrière. »

On observe cette même appétence pour le faire chez les étudiants des écoles d’architecture qui aspirent à des pratiques plus concrètes. L’échelle 1 est de plus en plus prisée par ces futurs professionnels qui y voient l’opportunité de réaliser un projet de A à Z, ce qui est plutôt rare durant les études.
Pour Nicolas Dorval-Bory, directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles (ENSA), qui a réalisé des pavillons avec ses étudiants de première année : « Loin d’un exercice isolé, fragmentaire, le projet du détail et sa construction à l’échelle sont l’occasion de balayer tous les aspects fondamentaux de l’architecture, de la petite à la grande histoire. » Et aussi de tordre le cou à l’idée selon laquelle les jeunes diplômés auraient une culture constructive insuffisante.

Et lorsqu’il est donné aux architectes confirmés de réaliser une cabane ou une installation dans un site exceptionnel, l’excitation est la même. Celle qui consiste à renouer avec l’acte de bâtir et une forme de bon sens qui revient avec force.
1 – Queyrières (Haute-Loire)
Suchaillou, de Constance Guisset
Sur l’un des chemins de Compostelle, la designeuse Constance Guisset a imaginé une œuvre d’art refuge dans un paysage de sucs, au col de Raffy. Cet abri troglodytique fait partie d’une série de cartes blanches confiées à différents artistes et créateurs.

Encastré dans la pente, Suchaillou est réalisé en pierre sèche. La porte et le mobilier sont en bois. Face à une vue exceptionnelle, la designeuse française a choisi de se fondre dans le site, avec une micro-architecture semblable à un minuscule soulèvement de la croûte terrestre, réalisé avec le savoir-faire des artisans locaux.
2 – Genève (Suisse)
Löyly, de Trolle Rudebeck Haar
C’est le projet de diplôme d’un étudiant devenu réalité. Pour clore son cursus à l’École cantonale d’art de Lausanne (ÉCAL), Trolle Rudebeck Haar a conçu un sauna flottant en bois sur le lac Léman. C’est en Finlande, où il a vécu, qu’il a découvert les vertus de la chaleur sèche.

Sur une plateforme de 2,2 mètres carrés, le sauna peut accueillir jusqu’à trois personnes et peut être installé dans de nombreux sites. Coiffé d’un toit incliné, Löyly comprend un poêle en bois, un banc, des fenêtres en verre translucide nervuré et une terrasse extérieure. Il est fabriqué en sapin de Douglas issu d’une scierie locale. Le designer a depuis créé son studio de design à Copenhague.
3 – Monaco
Regulus, de Guillaume Aubry
Architecte co-fondateur de l’agence Freaks et artiste-plasticien, Guillaume Aubry a été invité par le Nouveau musée national de Monaco à concevoir une folie lors d’une résidence.

Passionné par les couchers de soleil auxquels il a consacré une thèse, il a imaginé la sculpture architecturale Regulus dans les jardins de la Villa Paloma, l’un des deux sites du musée. Semi-circulaire, orienté plein sud et construit en briques pleines, ce pavillon héliotropique accompagne la course solaire. Avec son grand comptoir, c’est également un lieu d’hospitalité pour les visiteurs.
4 – Cerdanyola Del Vallès (Espagne)
MO.CA, des étudiants de l’IAAC
Face à la quête d’autonomie accélérée par la prise de conscience du changement climatique, les étudiants du Master en bâtiments écologiques avancés et biocités (MAEBB), de l’Institute for Advanced Architecture of Catalonia (IAAC), de Barcelone, ont imaginé la maison mobile MO.CA.

Ce prototype sur roulettes pouvant accueillir deux personnes repose sur une stratégie zéro kilomètre qui a guidé toute la fabrication. Le bois a été scié et transformé sur place pour construire cette caravane contemporaine qui fonctionne entièrement à l’énergie solaire. Bien que ses dimensions soient réduites (5,4 x 2,4 mètres au sol, 3,6 mètres de haut), elle intègre tous les équipements nécessaires au confort minimum.
5 – Lille et ses environs (Nord)
Festival Microtopies, du WAAO
Au bord de l’eau, dans la métropole lilloise, le Centre d’architecture et d’urbanisme WAAO organise Microtopies, un festival de cabanes invitant à reconsidérer la place de l’imaginaire et de l’utopie dans nos paysages urbains.

Pour sa troisième édition, architectes, designers et paysagistes ont expérimenté la construction à l’échelle 1 pour réactiver l’espace public, comme ici à Dunkerque, Bois-Grenier et Saint-André. Les douze micro-architectures ont été réalisées à partir de matériaux de réemploi. L’édition 2025 se déroulera cet été. Waao.fr
6 – Wismar (Allemagne)
Digital House, de Julian Krüger et Benjamin Kemper
Les architectes allemands ont imaginé cette micro-maison dans une forêt du nord de l’Allemagne. Née d’une conception numérique, elle comprend l’essentiel : fondations, sol, murs, ouvertures et toit.

Signe particulier, elle peut être montée sans clou ni vis, ni matériel spécifique par seulement deux personnes, grâce à un ingénieux système d’assemblage de joints cruciformes. La Digital House peut ainsi être démontée et remontée très facilement. Les façades sont en aluminium et la structure en bois, Julian Krüger et Benjamin Kemper ayant utilisé des matériaux issus des filières de réemploi.
7 – Lacaune (Tarn)
Stone Totems, de Benoît Maignial
Avant de dessiner, Benoît Maignial a observé le relief montagneux et tourmenté de cette magnifique région. Inspiré par l’histoire culturelle et cultuelle des lieux, l’architecte a installé quatre mégalithes aux entrées des territoires des monts de Lacaune et de la montagne du Haut-Languedoc.

Mêlant la figure du menhir et du dolmen, ils sont réalisés en pierre brute (gneiss et granit) avec le concours des savoir-faire locaux. Ces architectures sculptées dialoguent avec le paysage, les habitants du territoire, mais aussi les nombreuses statues-menhirs alentour.
8 – Versailles (Yvelines)
Trois pavillons, des étudiants de l’ENSA Versailles
S’il est aujourd’hui le nouveau directeur de l’École nationale supérieure d’architecture de Versailles, Nicolas Dorval-Bory y a d’abord enseigné. Notamment en première année, au sein de l’atelier « Détailler, formuler, construire », où il a accompagné les nouveaux arrivants du double cursus architectes-ingénieurs sur le chemin de la construction à l’échelle 1.

Pour la troisième édition, les vingt étudiants ont dessiné et fabriqué trois pavillons de 5 mètres carrés, noir, rouge et vert. Les contraintes ? Une porte, une fenêtre et les mêmes matériaux fournis à chaque groupe. Installés dans le potager du Roi, ils ont reçu le soutien du fonds de dotation Quartus pour l’architecture.
À lire aussi : Passion cabane : luxe planqué, nature retrouvée



 La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
 Terrass’ Hôtel
Terrass’ Hôtel
 Sifas
Sifas
 Ehia
Ehia
 Le Four à Chaux
Le Four à Chaux
 Ethimo
Ethimo
 Les Sources de Caudalie
Les Sources de Caudalie
 La Grande Maison
La Grande Maison
 La Course
La Course
 Hôtel de Tourny
Hôtel de Tourny
 Une Cuisine en ville
Une Cuisine en ville
 Côté rue
Côté rue