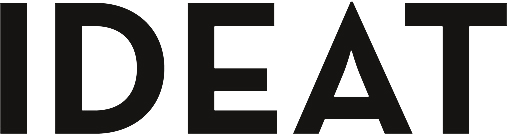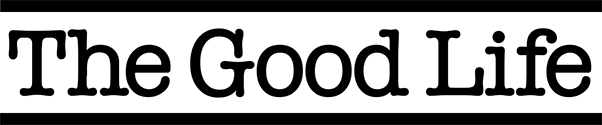Colonial. C’est le nom d’une des collections de mobilier outdoor signée Tectona. Couleur sable, elle “s’inspire d’un style caractérisé par une fusion entre l’élégance européenne et des influences exotiques, ayant émergé à l’époque des colonies”, explique la maison de meubles d’extérieur. La marque française n’est pas la seule à utiliser ce terme pour qualifier certaines de ses créations. La Redoute, ManoMano, Leroy Merlin, Castorama ou encore Brin d’Ouest, nombreuses sont les enseignes à proposer de pièces caractérisé par le terme “colonial”. Sur Pinterest, l’on trouve également des compositions de “terrasses coloniales” ou de “salon de jardin 4 places style colonial”. Accoler une période sombre de l’histoire à un domaine qui évoque la douceur de vivre, l’association peut surprendre voire choquer. Mais, ces univers ont-ils des liens communs ?
À lire aussi : Le nouveau TGV va-t-il (enfin) nous faire préférer le train ?
Mobilier outdoor et hybride
Par mobilier colonial, que faut-il comprendre ? Pour Laurence Bartoletti chargée d’études documentaires pour les collections XXe et XXIe siècle du MAD (le Musée des Arts décoratifs de Paris), le terme désigne “un mobilier outdoor assez hybride, parce qu’il vient de différents comptoirs et a pu essaimer par le biais du réseau colonial mis en place, par ceux qui voyageaient le plus, à l’instar des Portugais et des Hollandais. Comme il s’agissait de pays chauds, une esthétique légère et filaire était nécessaire, à travers l’utilisation de bambous, de la dentelle d’osier, etc. Quant aux matériaux, il s’agissait de ceux trouvés sur place, comme le bois de rose et le teck”, un incontournable des meubles de jardin de notre temps.

Autre habitué de nos terrasses, les pièces en cannage. Sur Britanica.com, soit l’extension numérique de l’Encyclopædia Britannica, on peut lire que ce maillage de cannes fendues puis tendues notamment sur les dossiers et les assises des chaises, a été fabriqué en Inde dès le IIe siècle après J.-C. Importée en Europe par la Compagnie des Indes orientales, la technique devient à la mode en Angleterre et aux Pays-Bas à la fin du XVIIe siècle. En France, elle est utilisée pour les meubles moins cossus pendant la Régence, mais aussi sous Louis XV. Un ensemble de techniques et de matériaux qui vont donner corps à “un mobilier qui s’est imposé comme le style des colonies, et que l’on retrouve uniquement dans la maison des maîtres, pas dans celles des esclaves ni des communes créoles”, explique Dimitri Zéphir, du duo Dach & Zéphir, spécialisé dans la valorisation de savoir-faire et de pratiques créatives oubliées et en relation avec les Antilles françaises.
Une étrange chaise « Planteur »
Parmi ces meubles figure une pièce bien étrange, la chaise “Planteur”. Un type d’assise que le designer Yassine Ben Abdallah a réinterprétée en l’augmentant de profilés en métal. “On la retrouve en Inde, en Indonésie, au Brésil, en Afrique du Sud et un peu dans tous les pays colonisés qui ont eu des plantations.” Avec un dossier incliné à 45 degrés, le fauteuil est équipé de palmes, cachées dans les accoudoirs, pensées pour y reposer les pieds.

Avec des origines difficilement identifiables, et issue de plusieurs typologies, “la chaise Planteur telle qu’on la connaîtrait aujourd’hui, serait héritée de l’Empire britannique, d’une chaise militaire pliable, explique le designer-chercheur. Exclusive aux hommes blancs, elle permettait à celui qui s’y asseyait de se perdre dans la contemplation du plafond ou du ciel afin de ne pas voir les domestiques. Cette posture n’était pas du tout adéquate sur le continent européen, mais l’était dans les colonies”. Une silhouette qui n’est pas sans rappeler nos traditionnelles chaises longues.
S’agirait-il de l’ancêtre de nos compagnes d’été ? “L’’histoire de la chaise longue est souvent reliée à celle du sanatorium, à ses manières de s’allonger. Il y a aussi le transat qui viendrait du transatlantique. Mais je pense qu’il y a cette question de la posture d’oisiveté qui apparaît dans les colonies, fortement réprimées en Occident. Les militaires européens dans les colonies pouvaient se les permettre. C’est de là que naît cette image de dignitaire qui sirote un gin allongé sur ces chaises planteurs. Il y a aussi des réalités météorologiques, du fait de la chaleur ou de l’humidité, qui donnent, petit à petit, l’autorisation à ces personnes de se languir de cette manière. Cette question de la langueur est vraiment fascinante et nous interroge sur qui peut se permettre de se reposer de la sorte sur un territoire occupé.”
« Je trouve que le terme “créole” est peut-être plus adéquat »
Ce droit au repos arrive en Europe au XXe siècle avec l’essor de “la société de loisirs”. Et Yassine Ben Abdallah de poursuivre : “À travers le travail que nous avons fait avec Mileno Guillorel-Obregón autour de la “Nieuwe Planter’s Chair”, nous voulions aussi souligner ce qui permet la construction de cette société de loisirs en Occident, à savoir l’accumulation de ressources matérielles, qui viennent du Sud. Ces profilés en métal sont un clin d’œil à Rotterdam, capitale de l’architecture moderne de vitres et d’aluminium, matériaux qui continue à être miné majoritairement dans des pays qui sont d’anciennes plantations. Cette chaise raconte l’histoire des trajectoires coloniales qui permettent d’enrichir l’Occident en exploitant en quelque sorte d’autres territoires.”
Créole plutôt que colonial ?
Pour le duo dach&zephir, “l’esthétique du mobilier colonial est réactivée à travers des matériaux végétaux comme l’acajou, le cannage et le teck qu’on utilisait énormément pour fabriquer des meubles aux Antilles et d’extérieur, donc destinés à ce qu’on appelle « la véranda » aux Antilles, cet espace semi ouvert vers l’extérieur, explique Dimitri Zephir. Alors bien sûr, il y a aujourd’hui des formes de réminiscences de ces typologies d’objets mais je dirais que c’est davantage sur des questions d’utilisation de matériaux et peut-être moins de styles de manière générale”.

“Le terme colonial est mal employé, ajoute Florian Dach. Pour notre part, nous préférons parler de mobilier créole. Parce que la France a envoyé des ébénistes français afin de former des personnes qui n’étaient, pour la plupart, plus esclaves. Le mobilier a muté, du fait de cette rencontre. Alors certes, cela date de la période coloniale, mais je trouve que le terme “créole” est peut-être plus adéquat, car il évoque des notions de rencontre de cultures. Le gros problème du terme colonial, c’est qu’il fait surtout référence à une période historique et aussi géographique. Peut-être faut-il le garder seulement et uniquement pour désigner sa capsule temporelle, à savoir le temps des colonies.” Le temps de changer de dénomination ?
À lire aussi : Young Scène Ouverte : le nouveau repaire des futures stars du design