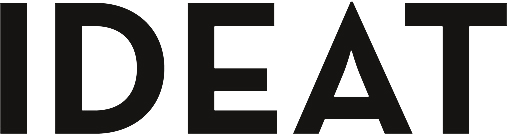En grande partie rasé par la Royal Air Force britannique en septembre 1944, dans le cadre de l’opération Astonia visant à détruire les défenses allemandes, le centre-ville du Havre renaît de ses cendres entre 1945 et 1964, grâce au génie d’Auguste Perret (1874-1954), l’un des architectes les plus célèbres du XXe siècle. Avec son atelier, il en fait un joyau de béton, offrant à la cité une revanche sur l’histoire et ouvrant la voie à son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco en 2005, soit soixante ans après le début des travaux. Une reconnaissance méritée qui fête aujourd’hui ses vingt ans !
À lire aussi : Portrait : Sou Fujimoto, poète de l’urbanisme blanc et des formes organiques
Le Havre : 20 d’inscription au Patrimoine mondial
De toute évidence, faire entrer un site au patrimoine mondial de l’Unesco n’a rien de simple, bien au contraire. Pour y parvenir, il doit posséder une valeur universelle, culturelle ou naturelle, si exceptionnelle qu’elle transcende les frontières nationales et revêt une importance commune pour les générations présentes et futures de toute l’humanité.

Depuis juillet 2025, la liste compte 1 248 sites, dont 54 en France. Parmi eux : le centre-ville du Havre dans son intégralité, soit une surface de 150 hectares, incluant les bâtiments conçus par l’atelier d’Auguste Perret, mais aussi le Musée d’art moderne André Malraux (MuMa), la Résidence de France (Candilis et Lamy, 1969), la passerelle métallique de Guillaume Gillet (dite Le Chevalier, 1969), ou encore la Maison de la Culture d’Oscar Niemeyer (1982), surnommée « Le Volcan », qui n’a rien à envier aux édifices de Brasilia. Soit autant de chefs-d’œuvre qui ont longtemps fait du Havre un laboratoire urbain parmi les plus fascinants au monde.
De ce fait, pour de nombreux spécialistes, l’entrée du Havre au patrimoine mondial de l’Unesco relevait de l’évidence. Et pourtant, il aura fallu dix années de travail, menées conjointement par la Ville du Havre et des experts en histoire de l’architecture, pour aboutir à cette reconnaissance. Parmi eux, l’architecte Joseph Abram : « Pour faire inscrire un site culturel sur la liste, il doit répondre au minimum à un des six critères exigés par l’organisation. Le Havre pouvait en cocher trois. »

Critère n°1 : représenter un chef-d’œuvre du génie créateur humain. En ce sens, l’Hôtel de Ville et l’église Saint-Joseph, signés de la main d’Auguste Perret, suffisaient à eux seuls.
Critère n°2 : témoigner d’un échange d’influences considérable sur le développement de l’architecture, de la technologie, des arts monumentaux ou de la planification urbaine. Or, entre les années 1920 et 1930, Le Havre accueillait des colloques de renommée mondiale sur ces thématiques, notamment sur le logement dans la ville nouvelle, ce que Le Havre est devenu.
Critère n°4 : offrir un exemple éminent d’un type de construction, d’ensemble architectural ou technologique illustrant une ou plusieurs périodes significatives de l’histoire humaine. Le Havre incarne parfaitement la phase de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale.
Auguste Perret : inspiré du passé, tourné vers l’avenir
« Contrairement à ses contemporains, Auguste Perret ne considérait pas la ville ancienne comme une catastrophe, au contraire, il y puisait son inspiration. Il souhaitait l’améliorer et non la remplacer », raconte Joseph Abram. Ainsi, dès 1945, grâce à son atelier chargé d’édifier 10 000 logements, des immeubles de bureaux et des commerces, Le Havre se pare de colonnes inspirées de l’Antiquité, d’îlots ouverts et rectangulaires pensés pour le bien-être des habitants, mais aussi d’une quantité phénoménale de fenêtres, l’un des éléments marquants de la cité.

« Comme les nombreuses colonnes – toutes différentes, mais parfaitement régulières – elles sont le fruit d’un usage révolutionnaire du béton armé, allié au préfabriqué et à une trame répétitive et modulaire de 6,24 mètres, libérant des surfaces de plus de 36 mètres carrés : un luxe. Ainsi, les architectes ont pu concevoir, avec une grande économie et sur une trame commune, des variations et une certaine musicalité dans la ville », précise-t-il.
À la fois expert des architectures d’antan et inconditionnel des nouvelles technologies, Auguste Perret n’a cessé de bâtir des ponts entre mémoire et futur. Malgré les importants dommages causés par les bombardements, le génie n’a pas souhaité faire table rase du passé. Il a tenu à conserver les trois principaux axes historiques de la ville qui formaient un triangle monumental, bien visible sur les photographies du désastre. Sous sa houlette, la rue de Paris, datant de 1517, prend des allures de rue de Rivoli, avec ses arcades et ses commerces sous les habitations. Ouverte en 1852, l’avenue Foch devient les Champs-Élysées du Havre. Enfin, le boulevard François Ier, tracé en 1864 à l’emplacement des anciennes fortifications, se refait une beauté.

Pourtant pas très catholique – au sens propre – Auguste Perret a tenu à se charger lui-même de la reconstruction de l’église Saint-Joseph, qu’il a érigé en un incroyable phare, à la fois spirituel et profane, culminant à 107,23 mètres. Devenue malgré lui le symbole de la ville, l’édifice impressionne.
« Pas étonnant : digne d’un gratte-ciel, il fait écho à l’un de ses grands projets imaginés en 1926, celui de la basilique Sainte-Jeanne-d’Arc, qui devait dépasser les 200 mètres, mais aussi à l’église en béton de Notre-Dame du Raincy, chef-d’œuvre achevé en 1923. Le socle est à hauteur de rue, la tour, elle, à hauteur de ville », rayonnant bien au-delà… jusque de l’autre côté de l’Atlantique, à New York, à qui elle adresse un sublime hommage lumineux, tel un testament. Auguste Perret décède en 1954, trois ans après cette prouesse, laissant derrière lui une œuvre pharaonique : une cité unique au monde, un exemple pour les générations futurs.
À lire aussi : La nouvelle promenade de La Grande Motte, un hommage à Jean Balladur



 La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
La Manufacture : Là où la mode rencontre le design…
 Terrass’ Hôtel
Terrass’ Hôtel
 Sifas
Sifas
 Ehia
Ehia
 Le Four à Chaux
Le Four à Chaux
 Ethimo
Ethimo
 Les Sources de Caudalie
Les Sources de Caudalie
 La Grande Maison
La Grande Maison
 La Course
La Course
 Hôtel de Tourny
Hôtel de Tourny
 Une Cuisine en ville
Une Cuisine en ville
 Côté rue
Côté rue