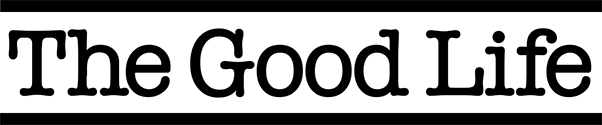ChartierDalix : Le vivant, matériau d’architecture
Frédéric Chartier et Pascale Dalix ont créé leur agence ChartierDalix en 2008 et font partie des signatures françaises qui comptent. Nous sommes allés à leur rencontre afin de comprendre comment Accueillir le vivant* dans leurs bâtiments
est devenu une question qui traverse toute leur production, envisagée comme le support d’une nouvelle sociabilité.
Comment avez-vous commencé à vous intéresser à intégrer le vivant dans l’architecture ?
Le premier projet de l’agence était une extension d’école élémentaire à Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne). Nous y avions travaillé le végétal, de façon très simple, avec du lierre et des câbles en Inox pour lui permettre de se déployer et de recouvrir le bâtiment. La toiture existante était prolongée tout comme le jardin, qui venait occuper la façade ainsi créée. Mais le véritable déclencheur, c’est le groupe scolaire des sciences et de la biodiversité, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), où nous étions invités à réfléchir au moyen d’intégrer le vivant au programme.
D’où est venue cette spécificité du programme ?
Il y avait l’idée, impulsée par Aurélien Huguet, consultant en écologie qui travaillait alors pour la SAEM Val de Seine Aménagement, d’imaginer un îlot refuge dans un territoire très construit et de poser la question de la superposition de la nature avec l’architecture. Ou comment, plutôt que d’accoler un bâtiment et un square, mixer les deux pour n’en faire qu’un seul élément. Cela nous intéressait, puisque nous concevons souvent des architectures sans face avant ni face arrière. Nous essayons toujours de proposer une continuité dans la réponse qu’offre l’édifice afin qu’il diffuse une même générosité partout. À Boulogne-Billancourt, nous avons réfléchi à ce que pouvait être une façade qui accueille autre chose qu’une isolation thermique et des fenêtres, pour arriver à la conclusion que cette façade devait créer du possible.
C’est-à-dire ?
Le vivant a besoin de profondeur pour s’installer. Il suffit de regarder la coupe d’un arbre et la différence entre ses parties haute et basse. Nous sommes fascinés par les façades très minces, comme celles des bâtiments de Sanaa (qui a notamment signé la peau en verre de la Samaritaine, NDLR), mais pour fabriquer un milieu, il faut retrouver des notions de profondeur et d’épaisseur. Idem avec l’eau, vitale pour accueillir le vivant. Or elle est l’ennemie jurée de l’architecture. C’est un paradoxe qu’il s’agit de résoudre. À Boulogne-Billancourt, il ne fallait pas retenir l’eau, simplement la ralentir. Chacun des blocs de béton qui forment l’enveloppe est équipé de stries et de cannelures qui la laissent circuler d’un bloc à l’autre. L’eau prend ainsi son temps. Lorsqu’on travaille avec le vivant, la question du temps devient très présente.
Le vivant permettrait-il de réinterroger l’architecture ?
Intégrer le vivant implique effectivement de penser l’architecture différemment et pose une somme de questions techniques et conceptuelles, qui font qu’un autre langage peut se créer. Nos fondamentaux sont ainsi remis en cause. Si un toit peut avoir de nouvelles fonctions, pourquoi pas une façade ou un sol ? Il est salutaire que notre métier se réinterroge sur les formes architecturales, car on dispose de techniques qui ont beaucoup évolué depuis un siècle.
Comment vous êtes-vous formés à la question du vivant ?
En collaborant avec des écologues (qui se penchent sur l’impact des activités humaines sur l’environnement, NDLR) notamment, qui, par leur approche, sont eux au contact de besoins qui nous manquent à l’agence. Dessiner l’inerte, nous pouvons y arriver. En revanche, pour dessiner le vivant, il faut faire le choix des espèces, bien connaître les milieux, ce qui est plus complexe pour un architecte. Il s’agit moins d’approfondir le design du végétal que la mise en place d’un système. Ce qui nous motive, c’est d’introduire le vivant comme partie intégrante d’un bâtiment.
Vous défendez une approche où architecture et paysage sont en fusion ?
Oui, et c’est pour cette raison qu’il est intéressant d’associer la discipline de l’écologue à celle de l’agence, dès la conception d’un programme. Cette pratique et son objet trouvent ainsi une place plus légitime et naturelle. Lorsque le paysage est rapporté une fois le projet dessiné, la fusion est moins aisée. Nous veillons toujours à ce que le paysage soit le plus proche possible des utilisateurs, pour favoriser les interactions entre eux, peu importe qu’il s’agisse de bureaux, de logements ou d’écoles. Aujourd’hui, le groupe scolaire de Boulogne-Billancourt est un véritable outil pédagogique qui a permis à toutes les classes d’établir un programme environnemental.
Ou comment l’architecture peut devenir le support de nouveaux usages…
Absolument. Ce qui est très beau à Boulogne-Billancourt, c’est cette fusion entre l’architecture, les humains, grands et petits, et le paysage vivant. Il y a des endroits sanctuarisés où les enfants n’ont pas le droit d’aller, mais aussi un vaste espace de travail qui permet aux élèves d’expérimenter, de pratiquer, de retrouver le sens de l’intérêt commun, mais aussi d’œuvrer à la transmission entre enseignants, entre enseignants et petits et entre les enfants eux-mêmes… Que ce soit à travers l’enseignement ou durant le temps périscolaire, une belle histoire s’établit depuis quelques années autour de cette école. Cette fusion est intéressante, car il ne s’agit ni d’un apparat ni d’un prétexte pour atténuer la densité d’une construction : elle est inhérente à la conception du projet.
Vous vous penchez aussi sur la notion de bâtiment ressource. Pouvez-vous nous l’expliquer ?
Le premier confinement nous a permis de creuser cette idée. Face aux questions de résilience alimentaire, qui sont apparues de manière extrêmement forte au grand public à travers la crise sanitaire, nous avons réfléchi à un bâtiment qui n’offre pas uniquement de beaux espaces qualitatifs, mais qui prenne également en charge les besoins fondamentaux de ses habitants, comme se nourrir. Sur la toiture de l’hôtel logistique Sogaris, dans la ZAC Gare Ardoines (Val-de-Marne), nous avons imaginé un hectare planté pour développer des activités maraîchères. À Nice, sur un immeuble de 137 logements que nous réalisons, nous obtenons une production qui couvre entre 10 et 20 % des besoins alimentaires des habitants en fruits et légumes.
Ces espaces dévolus au comestible sont également les lieux de partage qui font souvent défaut au logement collectif…
Intégrer le vivant implique de s’engager pour l’environnement, d’interroger l’architecture, mais revêt effectivement une dimension sociale très forte. Qui s’occupe de l’entretien de ces zones de culture comestible ? Comment faire vivre un tel bâtiment ? Comment se partage-t-on les tâches ? Travailler avec le vivant, c’est redonner aux habitants la main sur l’endroit où ils vivent. Dans le même esprit, aujourd’hui, nous travaillons très souvent sur des logements qui renouent avec les coursives extérieures comme moyen d’accès.
Parce qu’elles offrent des lieux de sociabilité qui participent à la qualité du fait d’habiter ?
La coursive extérieure devient un espace collectif, une promenade verticale entre la rue et le logement, un lieu de rencontre et de partage. C’est ce que nous avons proposé avec l’immeuble de la rue de l’Asile-Popincourt, à Paris (XIe). Dans le logement collectif, les circulations communes demeurent l’un des rares leviers dont dispose l’architecte aujourd’hui pour créer du vivre ensemble. Ce sont les seuls espaces où les habitants se croisent. Or ils sont souvent sacrifiés sur l’autel de la rentabilité.
L’un des seuls leviers, car le système de production du logement collectif en France est très contraint. La marge de manœuvre des architectes est limitée.
En effet, aujourd’hui, les toits, les espaces extérieurs et les rez-de-chaussée forment la seule marge de manœuvre dont nous disposons, en attendant une prise de conscience sur le logement lui-même. Sortir les circulations démultiplie les possibilités. Elles deviennent un support pour cet immeuble ressource, mais aussi des endroits privilégiés de la vie collective. À Chevilly-Larue (Val-de-Marne), des passerelles relient les différents plots. Toutes les circulations sont extérieures tandis que serres et jardins s’installent sur les toitures. Alors qu’il y a très peu de squares dans ce quartier, le bâtiment offre ainsi des endroits très privilégiés où les enfants peuvent jouer et courir, par exemple.
Certains maîtres d’ouvrage ont donc compris l’intérêt de ces espaces extérieurs qui façonnent les conditions de la vie collective…
À Chevilly-Larue, il s’agit d’un maître d’ouvrage rencontré à nos débuts, avec qui nous avons développé une relation de confiance. Toutes ces coursives ne sont pas de simples lieux de passage. Comme elles sont généreuses, on peut y installer une table, des chaises, des plantes… On peut y façonner la sociabilité du bâtiment. À l’origine des logements de la rue de l’Asile-Popincourt, il y a une toute petite parcelle, nichée dans un tissu ancien, extrêmement dense. Nous avons mis en connexion les vides des cours d’immeubles, en reliant les bâtiments sur rue par de larges coursives plantées et des escaliers extérieurs. Ce n’est pas uniquement du vivant, mais c’est suffisant pour déclencher une forme de sociabilité.
Les maîtres d’ouvrage se montrent-ils parfois frileux ?
Oui, ils ont parfois peur des jardinières, d’une terrasse végétalisée, de choses pourtant basiques. Il faut leur faire accepter la nécessité de l’entretien de ces équipements, même s’il peut être aisément réalisé. La toiture de l’école de Boulogne-Billancourt exige seulement une ou deux fauches par an, rien de très contraignant. Nous approfondissons aussi la question de l’autonomie de l’eau. Nous venons d’installer trois prototypes de murs biodiversitaires au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN). Ce ne sont pas de simples murs végétalisés, mais des systèmes verticaux quasi autonomes, des parois complètes à la fois fonctionnelles et structurelles, pour lesquelles nous avons d’ailleurs déposé un brevet.
Comment est née cette histoire ?
C’est le fruit d’une recherche menée en partenariat avec le MNHN, FAIRE Paris (l’appel à projets urbains innovants notamment soutenu par la Ville, NDLR) et le Pavillon de l’Arsenal. Il y a plusieurs histoires dans l’histoire. À la suite du projet de Boulogne-Billancourt, nous avons eu envie de continuer à expérimenter avec le béton, qui présente un intérêt dans cette expérience, puisqu’il se comporte plus ou moins comme la pierre. Il possède une certaine inertie thermique, retient l’humidité et permet de travailler la profondeur. Nous souhaitions prolonger cette histoire à travers d’autres prototypes en brique, en pierre et en monomur (une brique alvéolaire isolante, NDLR). Ceux-ci s’agencent de telle manière qu’un espace libre intérieur est ménagé pour accueillir le substrat. Ces prototypes vont faire l’objet d’un suivi pour évaluer le comportement du substrat et des végétaux au fil des saisons. En parallèle, nous collaborons avec Vinci (un leader mondial de la construction et de l’énergie, NDLR), avec qui nous construisons le nouveau siège de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le site de l’hôpital Saint-Antoine dans le XIIe. L’AP-HP nous accompagne pour mettre en place ce mur habité qui va être le premier exemplaire de mur en béton à accueillir le vivant.
Une manière de replacer la biodiversité au cœur du projet architectural ?
L’architecture, c’est la nouvelle géographie. Aujourd’hui, la terre est tellement construite qu’il est difficile de penser que l’architecture est uniquement là pour l’homme, elle doit aussi accueillir le vivant. Désormais, lorsque nous observons un site, nous travaillons systématiquement avec un écologue. Qu’est-ce qui est déjà là ? Que devons-nous préserver ? Paris a par exemple perdu quasiment la moitié de ses oiseaux depuis les années 70. Ils n’ont plus d’endroit où nicher puisque la plupart des combles ont été récupérés. À Boulogne-Billancourt, l’enveloppe offre une petite centaine de nichoirs dans les blocs. La taille des trous correspond exactement aux oiseaux qui sont attendus sur le site. Il y a eu deux ans de repérage auparavant pour observer quelles espèces étaient concernées. C’est très précis.
Comme pour les humains !
Oui ! Si une table de bureau est trop haute ou une chaise de bureau trop basse, c’est inconfortable. Il s’agit de retrouver des notions d’échelle qui permettent au vivant de s’installer dans de bonnes conditions. De la même manière, à propos de la tour Montparnasse**, par exemple, nous nous posons beaucoup de questions sur les patios, les espaces extérieurs et le grand jardin suspendu du 16e étage. Qu’est-ce qu’on y met ? Comment travaille-t-on la hauteur ? Comment prolonge-t-on les espaces extérieurs des bureaux, la partie basse de la tour qui vient s’insérer dans la nappe haussmannienne ? Qu’est-ce que c’est ? Nous réfléchissons pour que tout cela ait un sens.
À chaque projet, vous vous posez donc la question du vivant et de la façon dont il peut être intégré à l’architecture ?
Oui. On ne peut faire abstraction des écosystèmes qui nous entourent, même dans le milieu extrêmement artificiel qu’est celui de la ville. Nous sommes de plus en plus nombreux à habiter des métropoles en pleine croissance : elles doivent devenir vivables. Un milieu urbain, certains n’ont pas la possibilité ni les moyens d’en sortir et en sont captifs. Il faut donc s’adresser à eux et considérer que l’endroit où l’on vit ne peut pas être seulement artificiel, au risque de causer des dégâts mentaux ou physiques… Mais cette question est aussi légitime que celles concernant le bilan carbone d’une opération, les possibilités de réhabilitation, la nécessité d’offrir des espaces les plus collectifs possible… La liste est longue. Le vivant est un outil complémentaire de conception. C’est ainsi que nous l’envisageons. Il y en a d’autres qui arriveront peut-être plus tard. Mais c’est effectivement quelque chose qui fait désormais partie de notre pensée. C’est une voie qui nous motive, qui nous donne envie de nous lever le matin.
Une évidence pour vous, mais est-ce un nouveau paradigme ?
Il ne faut pas être dogmatique. Nous avons besoin de nous poser cette question au démarrage de chaque projet et aussi durant son développement. Comment, dans un bâtiment de logements, où les habitants peuvent vivre vingt ans sur le même palier sans se connaître, recréer de l’« espace » commun à partir de la question du vivant ? Si on part du principe que ce bâtiment porte son propre paysage et des surfaces dévolues à la subsistance de ses habitants, on ouvre un champ des possibles qui va au-delà de notre seul travail d’architecte. Peut-être notre métier est-il en train de changer… Parce que si la densité n’apporte pas la sociabilité, le végétal peut beaucoup. Neuf fois sur dix, c’est spectaculaire. Qu’il s’agisse de jardins, d’un toit-terrasse, d’un balcon ou d’un lieu partagé au cœur d’un immeuble, il se passe toujours quelque chose dans ces espaces. C’est un matériau très intéressant à travailler, un accélérateur de sociabilité. Il ne s’agit pas de « faire joli ». Le végétal offre bien d’autres vertus que celles brandies par le greenwashing.
> ChartierDalix, 27, rue Popincourt, 75011 Paris. Chartier-dalix.com