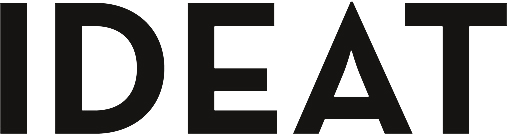Hier emblème d’hypermodernisme et porteur d’une utopie sociale, aujourd’hui souvent décrié, le brutalisme a, semble-t-il, perdu de son aura. Né dans le béton, à l’aube des années 1950 en Europe de l’Ouest, il s’est construit autour d’une utilisation massive et sans fioritures de ce matériau, particulièrement innovant à l’époque. Alison et Peter Smithson, Marcel Breuer, Ernő Goldfinger, Jacques Kalisz, Bertrand Goldberg et, bien sûr, Le Corbusier, avec sa Cité Radieuse, en furent les principaux protagonistes, revendiquant, à travers leurs réalisations, le caractère sauvage, naturel et primitif de ce courant. Mais à la fin du XXe siècle, le brutalisme s’effondre. Synonyme de lourdeur et d’austérité, il est de plus en plus impopulaire. Mais tout n’est pas à jeter. Voici 5 bâtiments un brin fantaisistes – voire oniriques – qui pourraient bien changer votre regard.
À lire aussi : Tendance : le retour du brutalisme en décoration
1. L’élancé : la Geisel Library, San Diego, États-Unis
Pépite du brutalisme, la Geisel Library trône fièrement au cœur de l’université de San Diego, dont elle est devenue le symbole, faisant la fierté de la scène architecturale californienne. Conçue par William Pereira en 1970, elle se distingue par son extraordinaire légèreté apparente.

Ce trompe-l’œil est dû à une structure en porte-à-faux reposant sur de puissants piliers inclinés et recouverte de miroirs reflétant le ciel. Elle doit son nom à Theodor Seuss Geisel, plus connu sous le pseudonyme de Dr. Seuss, écrivain prolifique de livres pour enfants et grand mécène de l’université. Renfermant un précieux savoir, elle apparaît, aux yeux de celles et ceux qui la découvrent, tel un « phare de la connaissance ».
2. Le mystique : L’Abbaye de Collegeville, États-Unis
L’abbaye de Collegeville a inspiré au scénariste et réalisateur américain Brady Corbet son film The Brutalist (2024), récompensé par trois Oscars, dont celui du Meilleur acteur décerné à Adrien Brody. Ce beau coup de projecteur pourrait remettre en lumière son architecte, Marcel Breuer, héritier du Bauhaus, qui l’a fait surgir de terre, en pleine campagne du Minnesota, dans les années 1950.

Dotée de volumes sculpturaux, d’un impressionnant campanile ajouré, d’un clocher plat ou encore d’une façade constituée de centaines d’hexagones, l’abbaye apparaît comme un monument unique, à la croisée de l’antique et de la science-fiction.
3. Le ludique : Habitat 67, Montréal, Canada
Favela des temps modernes, Habitat 67 a été érigée en 1967 dans le cadre d’Expo 67 et a valu à son créateur Moshe Safdie, âgé de seulement 29 ans à l’époque, une renommée internationale.

Pour ce projet, le jeune prodige a mis en pratique les idées développées dans sa thèse, A Three-Dimensional Modular Building System, dans laquelle il s’intéressait tout particulièrement à l’architecture urbaine préfabriquée, à haute densité et à prix réduit. Chacun des 345 modules — mesurant 11,7 × 5,3 × 3 mètres — a été façonné dans une usine construite tout spécialement, à proximité du chantier, puis assemblé à l’aide d’une grue, tel un jeu de Lego grandeur nature !
4. Le végétal : les Choux de Créteil, France
Amusants, les célèbres Choux de Créteil sont la preuve que certains architectes brutalistes, loin d’être rustres, ne manquaient pas de fantaisie. Signé Gérard Grandval, construit entre 1969 et 1974, ce grand ensemble résidentiel de dix tours rondes de 14 étages détonne dans le paysage urbain. Ses balcons en corolle lui donnent des airs de choux-fleurs et une silhouette organique, en décalage avec la rigidité du béton.

À l’origine, l’architecte souhaitait même les végétaliser, mais les promoteurs s’y sont opposés – un choix bien regrettable. Labellisés « Patrimoine du XXe siècle » en 2008, les Choux de Créteil sont malgré tout devenus l’un des symboles de l’audace de l’architecture populaire française.
5. L’OVNI : le sanatorium de Druzhba en Crimée, Ukraine
Œuvre brutaliste tardive, inaugurée en 1985, le sanatorium de Druzhba en Crimée n’en reste pas moins l’un des bâtiments les plus étonnants de ce courant. Telle une soucoupe volante posée sur les falaises de Kourpaty, surplombant la mer Noire, il fait écho à une époque révolue.

Autrefois en vogue dans la région, la plupart des sanatoriums ont dû fermer leurs portes après la chute de l’URSS. Réalisé par une équipe d’architectes de l’Institut Kurortproekt, dirigée par Igor Alexandrovitch Vassilevski, ce bâtiment circulaire, couronné d’une plate-forme panoramique, rompait avec l’architecture soviétique d’alors tout en lui offrant de nouveaux horizons.
À lire aussi : Coup de projecteur sur la nécropole Sexto Panteón de Buenos Aires, un trésor brutaliste oublié