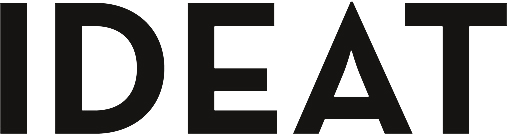À Évry, la cathédrale de la Résurrection Saint-Corbinien, imaginée par Mario Botta, se dresse comme un symbole du renouveau urbain. Une modernité souvent jugée austère, pourtant devenue cœur battant de la ville… et qui fait toujours autant débat.
À lire aussi : Exposition « Banlieues Chéries » : quand l’urbanisme raconte nos vies
La foi en béton : Mario Botta entre en scène
En 1965, le Général De Gaulle acte la construction de cinq villes nouvelles en périphérie de Paris afin de décongestionner la capitale qui connaît un boom démographique sans précédent. Évry sera la préfecture du nouveau département de l’Essonne, un pôle d’attractivité conçu selon un urbanisme moderne – certain diront sans âme – dense, emblématique en tous cas d’une certaine banlieue. Mais il manquait à la commune quelque chose d’essentiel : un cœur.

En 1984, l’évêque de Corbeil-Essonnes, Mgr Herbulot souhaite y édifier une cathédrale. Les travaux ne débuteront qu’en juillet 1992 et la première messe y sera célébrée à Pâques 1995. Construite en trois ans seulement pour un montant total de 65 millions de francs, la cathédrale de la Résurrection Saint-Corbinien d’Évry devient à la fois un lieu de culte pour le diocèse d’Évry-Corbeil-Essonnes et un symbole de renaissance pour la ville nouvelle. Et c’est Mario Botta, célèbre architecte suisse, qui la conçoit, pour qui « l’architecture religieuse décrit visuellement l’idée du sacré, qui est un besoin fondamental de l’homme ».
Controverses sacrées : la cathédrale d’Evry divise
Mais il fallait néanmoins bien une « sainte » polémique pour une telle audace architecturale. Certains pointent son inutilité, d’autant que l’Église catholique est en fort recul en France dans ces années 1990. « Aujourd’hui c’est un non sujet : la cathédrale est très fréquentée, animée par plusieurs messes par semaine qui font le plein chaque fois, se défend Mehdi Zeghouf, premier adjoint au maire de la ville et président de l’office de tourisme. Il fallait voir l’engouement qu’il y avait lors de la visite du pape Jean Paul II en 1997, c’était incroyable ! »

La cathédrale d’Évry demeure la seule à avoir été érigée en France métropolitaine au cours du XXe siècle. Un cylindre d’apparence assez austère et finalement plutôt modeste composé d’environ 800 000 briques rouges dont le toit est couronné d’un anneau de béton, lui-même surplombé d’une couronne de vingt-quatre tilleuls. Selon Mario Botta, son plan circulaire évoque la perfection du divin, comme l’évoquait Pascal dans ses Pensées (1670) : « Dieu est une sphère infinie, dont le centre est partout et la circonférence nulle part ».
À défaut de divinité, c’est en tous cas une géométrie cohérente. Avec un diamètre extérieur de trente-huit mètres et une hauteur maximale de trente-quatre mètres, l’édifice peut accueillir jusqu’à mille quatre cents fidèles, dont sept cents assis. L’intérieur est au contraire très graphique, avec d’élégants et chaleureux vitraux d’une modernité incroyable. La lumière zénithale comme allégorie évidente de la verticalité de Dieu souligne le raffinement à la fois pure et sobre du chœur.
Un lieu de culte devenu fierté urbaine
En 2011, la cathédrale est labellisée « Patrimoine du XXe siècle », puis ce sera « Architecture Contemporaine Remarquable » en 2020. « Ce bâtiment conçu d’abord pour le culte s’est inscrit très tôt dans la réflexion globale et l’édification même du centre urbain de notre ville, reprend l’adjoint au maire. Le label nous permet de valoriser plus facilement cette architecture ».

Paradoxalement, c’est dans cette ville nouvelle aux allures de cité que l’on trouve l’un des plus improbables symboles de modernité religieuse. C’est là tout le miracle. « Cela a redonné aussi une certaine fierté aux habitants. Nous organisons plusieurs dizaines de visites par an car la cathédrale interpelle. Les gens sont généralement surpris : on ne s’attend pas forcément à un lieu de culte aussi majestueux dans une ville comme la nôtre, loin des standards des cathédrales millénaires. Elle bouscule, mais elle est parfaitement intégrée. Il n’y a plus de débat, on en est très fiers. » Ou le triomphe du sacré en banlieue.
À lire aussi : Archi-culte : l’église Saint-Augustin, l’ovni en béton de la Grande-Motte