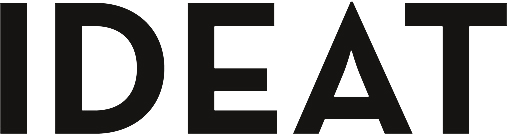Moins célèbre que Charlotte Perriand ou Jean Prouvé, Maxime Old (1910-1991) a pourtant dessiné une esthétique du quotidien subtile et résolument moderne. Artisan d’une ingéniosité feutrée, amoureux des lignes pures et des mécanismes discrets, cet « homme d’intérieurs » – titre de l’exposition qui lui est consacrée aux Beaux-Arts de Rouen jusqu’au 5 janvier 2026 – est de ces créateurs que l’on redécouvre avec étonnement, tant ses meubles semblent terriblement actuels.
À lire aussi : Pourquoi tout le monde adore Charlotte Perriand ?
Un couturier de l’intérieur
Ni designer au sens industriel, ni artisan d’art au sens patrimonial, Maxime Old échappe aux cases. Formé à l’École Boulle, il devient ensuite le dessinateur de Jacques-Émile Ruhlmann avant de reprendre en 1934 l’atelier familial d’ébénisterie. Tournant le dos aux meubles de « style » que fabriquait son père, il dessine et façonne des meubles pensés pour s’adapter à l’usage d’un client.

« Mon père dessinait cher », analyse Olivier Old, son fils, non par snobisme mais parce que chaque projet impliquait une recherche formelle, technique, presque psychologique. Refusant les dogmes du modernisme industriel, il préfère le sur-mesure. Chaque pièce est une œuvre unique, exposée au Salon des artistes décorateurs ou aux Arts ménagers, mais jamais produite en série, ce qui explique sans doute que son nom soit passé sous les radars et raisonne moins que celui d’un Pierre Paulin, qui a pourtant été son élève. Il ne s’agit pas de faire du design, mais d’adapter un meuble à un lieu, à un corps, à une relation. Il y a une vision presque anthropologique du mobilier, que l’exposition restitue avec justesse.
Un showroom de vie
Plutôt qu’un parcours chronologique, les deux commissaires, Florence Calame-Levert et Katell Coignard, ont souhaité ouvrir le parcours par une reconstitution de l’appartement de Maxime Old conçu dans les années 1950 pour sa famille, au 4 rue Monsieur-le-Prince, à Paris. Ce lieu, reconstitué à partir de pièces originales issues des archives familiales, servait alors de showroom domestique où les clients étaient reçus autour d’un dîner. « Il s’agissait de vendre la vie qui va avec », rappelle son fils Olivier.

L’épouse et l’enfant faisaient partie de cette mise en scène discrète, où le meuble n’était jamais un simple objet, mais un vecteur d’usages. La scénographie signée David Des Moutis met en tension l’épure du mobilier avec l’architecture classique du musée. Chaque pièce – secrétaire, bibliothèque, fauteuil – témoigne d’une recherche d’équilibre entre esthétisme et fonctionnalité. Ses meubles à transformation (pupitres pliants, bancs-coffres, tiroirs invisibles) rendent la vie plus fluide, plus intuitive.
Rien n’est tape-à-l’œil, tout est pensé. Et tout donne envie d’être utilisé. Les matériaux, eux aussi, racontent cette modernité sans dogme où les bois précieux côtoient des stratifiés Polyrey et Formica, sans hiérarchie. Maxime Old joue avec les ressources de son temps, les détourne, les raffine. Comme le résume Katell Coignard, il est « subtilement moderne ».
Un vocabulaire formel au service du corps
Après un passage par son l’atelier, le parcours se prolonge dans une salle consacrée à ses formes signatures : le piétement en X, le grand angle, le cercle tronqué. Autant de motifs récurrents dans son travail, mais jamais gratuits, qui répondent à une contrainte d’usage. Comment alléger une structure sans en compromettre la stabilité ? Comment libérer de l’espace autour d’une table sans gêner les mouvements ? Comment concevoir un meuble qui accompagne le geste, au lieu de le contraindre ?

Florence Calame-Levert y voit une parenté avec les « techniques du corps » (1934) de Marcel Mauss : la manière dont les objets façonnent nos gestes, induisent une posture, instaurent une relation. À contre-courant de la froideur fonctionnaliste et du fétichisme formel, ses pièces, loin d’être figées dans leur époque, paraissent aujourd’hui d’une modernité désarmante.
Rouen, territoire d’expérimentations
Si l’exposition a lieu à Rouen, ce n’est pas un choix anodin. C’est ici, au début des années 1950, que Maxime Old est repéré par le docteur Guy Rambert, collectionneur et amateur éclairé d’Arts décoratifs, qui lui confie l’aménagement de son cabinet médical, puis de son logement. De cette première collaboration naît un lien durable avec la ville, jusqu’à une commande publique d’envergure : la salle du Conseil de l’Hôtel de Ville (qui peut aussi se visiter).

Ce chef-d’œuvre d’architecture d’intérieur, aujourd’hui en passe d’être classé monument historique, révèle une autre facette du créateur. Celle d’un ensemblier capable d’orchestrer l’espace dans sa globalité. Plafonds à caissons métalliques, portes stratifiées monumentales, bureaux, banquettes aux lignes géométriques… Le résultat est à la fois rigoureux, solennel et accueillant.
Alors que les galeries internationales comme Maison Gérard (New York), à qui a été donné une carte blanche dans une ultime section, réintroduisent les meubles de Maxime Old dans des décors contemporains, cette exposition redonne toute sa place à un créateur et décorateur discret, qui ne cherchait pas à imposer une signature mais à imaginer des situations. Un « inconnu majeur », selon les mots de son fils, à (re)découvrir.
> Exposition « Maxime Old, homme d’intérieurs », jusqu’au 5 janvier 2026 au musée des Beaux-Arts de Rouen. Plus d’informations ici.
À lire aussi : Rencontres d’Arles 2025 : nos expos coups de cœur à voir absolument