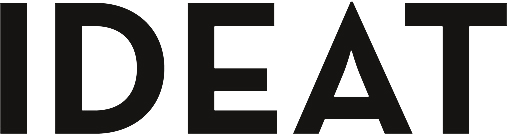Il aura fallu 20 ans, entre le premier rendez-vous dans le bureau du maire d’Arles et l’ouverture de ce musée. Un périple pour honorer la culture de la mode dans un écrin élégant, signé du duo d’architectes Studio KO.
À lire aussi : Exposition : Paul Poiret, l’art total d’un couturier visionnaire
Une maison du XIVe siècle pour accueillir l’histoire du vêtement
Les sœurs Costa, héritières et dirigeantes de Fragonard, reçoivent rue de Calade dans cet hôtel particulier – l’hôtel Bouchaud de Bussy, dont la première mention dans les documents historiques remonte à 1385 – entièrement restauré et détricoté après 5 années de travaux. C’est une rencontre avec le jeune Clément Trouche (désormais directeur du musée), passionné de costumes, historien du costume arlésien, « quasiment né avec un ruban sur la tête », plaisante Agnès Costa, qui initia l’entreprise.






« Une des grandes chances de ma vie, raconte-t-il, a été de rencontrer Agnès et Françoise Costa, d’avoir eu une oreille attentive et de bénéficier aussi de leur profond respect pour l’histoire de la mode et du costume provençal, puisque, quand même, dès 1997, elles ont ouvert un musée dédié aux costumes et aux bijoux à Grasse, avec les collections de leur mère dont elles sont aujourd’hui les garantes. »
Lui ne rêvait que de ça, un lieu arlésien pour dévoiler l’étendu des beautés de deux grandes collections de costumes : celle des sœurs Costa mais également celle constituée par Magali, disparue en 2015, et sa fille Odile Pascal, que la maison Fragonard a racheté pour pouvoir retracer entièrement l’histoire de la mode arlésienne depuis le XVIIe siècle. Les sœurs Costa l’ont fait. Avec l’art et la manière.
Studio KO, alchimistes du patrimoine arlésien
En choisissant Studio KO, l’agence d’architecture fondée en 2000 par Karl Fournier et Olivier Marty, les sœurs Costa plaçait dès le départ leur projet dans une grande ambition et un style donné : celui des couleurs chaudes, du minimalisme élégant dont l’agence a fait sa signature, et du devoir d’une réhabilitation dans les règles de l’art. Il a d’abord fallu dépecer six siècles d’altération pour comprendre les strates du temps.
L’adresse, bien connue des Arlésiens, était en effet une maternité dans les années 60 – appelée Le Nid -, puis un hôtel. Un ascenseur obstruait par exemple toute la cour actuelle. Tailleurs de pierre, ferronniers, façadiers et électriciens se sont alors succédés. Les enduits à la chaux ont été refaits. Puis vint le travail du studio pour compartimenter l’espace et réfléchir à la scénographie. « Nous avons libéré les volumes », confie le duo. « Karl et Olivier ont réussi, avec une poésie immense, à restituer l’âme d’un lieu sans avoir à le pasticher, s’enthousiasme Clément Trouche. Ils ont fait de ce musée un écrin absolument extraordinaire pour les œuvres et les collections qui vont s’y succéder au gré de la programmation. » Deux expositions par an sont pour l’instant prévues.
Déambulons désormais avec le directeur. D’abord devant cette façade, si propre qu’elle en est presque suspecte dans cette ville antique qui mêle avec panache les époques et la poussière. Au coin du bâtiment, un médaillon en fer forgé est accroché au mur grâce à deux boucles qui s’entrecroisent. Il représente une médaille de coulas, le bijou emblématique des Arlésiennes, qu’elles portent depuis le XVIIIe siècle.
Du clair-obscur à l’intime
Puis la porte, majestueuse, donne sur une silhouette noire. On est loin des étoffes colorées qu’il nous sera donné d’admirer plus tard. Enfin, passée la boutique, la première pièce est un cabinet de curiosité où chaque vitrine révèle un trésor, souvent symbolique pour le musée. Citons une robe de cour jaune devenue totem, achetée alors que les sœurs Costa, Clément Trouche et le duo KO sont en rendez-vous de travail. Le couloir dévoile une fenêtre où un modèle tourne très lentement – il faut deux longues minutes pour voir la silhouette faire un tour complet.






« C’est une demande que nous avions pour les architectes, explique le directeur. Nous voulions que les visiteurs perdent la notion du temps. » Devant une vidéo, commandée à l’artiste et photographe Charles Fréger, difficile de ne pas rester bouche-bée. Les costumes prennent vie dans 9 médaillons où 9 Arlésiennes bien d’aujourd’hui s’habillent. Un hommage aux gestes et au temps long, justement.
Sitôt quitté le rez-de-chaussée, sa lumière naturelle et ses teintes de référence au XVIIIe siècle, le majestueux escalier (non altéré par les couches ajoutées par les différents propriétaires), habillé de voiles de bateaux drapés par un cordage, amène vers une galerie tamisée et bouscule nos notions d’espace. « Pour préserver nos collections, nous avions besoin du noir, continue Clément Trouche. Karl et Olivier ont pensé à accompagner le visiteur vers la pénombre. Nous allons être happés et plongés dans le noir par un couloir dont l’enduit lui-même se dégrade tous les centimètres. »
Puis la grande galerie dévoile chronologiquement l’histoire de la mode arlésienne, face aux costumes portées partout ailleurs en France. Histoire de déceler ce que l’Arlésienne prenait ou transformait de la mode. Histoire aussi de raconter cette ville si particulière et son goût pour le vêtement.
Pourquoi Arles ? Parce que les femmes y ont toujours eu voix au chapitre
Une question qu’il ne fallait pas poser à Clément Trouche, « Arlésien donc chauvin, sourit-il. C’est une ville de culture et les femmes y ont toujours joué un rôle important. C’est à Arles que la première femme a été admise dans une académie française [Ndlr : Antoinette Deshoulières (1637-1694)]. Ici, toujours, que nous avions une école des Beaux-Arts avec une classe de peintres femmes. Les femmes ont toujours prix une part absolument incroyable dans la cité. On était sans doute un peu plus libre ici, c’était plus facile qu’ailleurs. On le voit par exemple avec les parents du célèbre peintre Jacques Réattu, son père était un aristocrate, Guillaume de Barrême de Châteaufort, sa mère, Catherine Raspal, n’était pas de la même condition. Pourtant, ici, ils pouvaient vivre librement. Les femmes se sont servis de la mode pour s’exprimer et être sur le devant de la scène, c’est aussi ce que ce musée raconte. » Et d’ajouter : « Cette ville, je crois, est à l’origine de ces âmes libres. À Arles, on résonne différemment. »
> Musée de la mode et du costume, 16 Rue de la Calade, Arles. Ouverture le 6 juillet 2025.
À lire aussi : 5 musées au design intersidéral : quand l’art s’expose dans des vaisseaux spatiaux