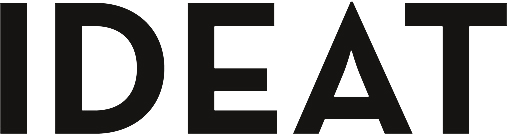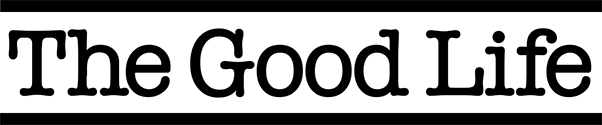C’est bien pour se raconter des histoires et les partager que la magie opère lorsqu’il est question de nourriture, affirme Rémy Luca, psychosociologue de la cuisine et du goût depuis plus de quarante ans. “On veut manger des scénarios, par vagues et par thème”, précise le spécialiste. L’American food a d’abord eu son heure de gloire dans les années 80 à travers l’émergence de McDo, Burger King et de l’implantation de tous ces fast foods sur les aires d’autoroute françaises façon route 66. “Premièrement rejetée, l’idéologie américaine a été adoptée comme l’extension d’un rêve américain francisé”, affirme l’auteur de Mythologies gourmandes (PUF. 2012).
Ainsi, s’invitent massivement dans les brasseries et cantines de l’Hexagone, steak frites et autres burgers gourmets agrémentés de fourme, bleu et même foie gras pour se la jouer américain, oui, “mais à la sauce poivre tant qu’on y est”, plaisante Rémy Lucas. Aujourd’hui, non sans histoires à raconter, on les retranscrit sur le vieux continent plus fidèles que jamais à leur identité américaine originelle. “Sans l’embourgeoiser, on déplace donc le bagel new-yorkais de rue chez Bob’s Bakery ou Fitzcarraldo, la pizza vendue à la part dans des assiettes en carton chez Rori ou Jay’s Pizza, et les hot-dogs américains au ketchup, dégoulinant et fidèles à eux-mêmes, dans les avenues Haussmanniennes”, constate le psychosociologue. Décryptage d’un phénomène populo-chic qui se mange du regard — et préférablement du bout des doigts.
À lire aussi : PMU remix : kitsch mais cool, une esthétique du réconfort
American dream sauce au poivre
Rouge comme la sauce tomate, vert comme le pesto, blanc comme la pâte à pizza… Les couleurs de l’Italie forment l’identité visuelle de Red Sauce, cantine italo-américaine fraîchement installée au cœur du Xe dans un ancien bâtiment des années 1970. Banquettes carmin, lumières tamisées, néons étincelants, comptoirs en inox ouverts sur une cuisine fumante, ventilateurs au plafond… Tout y est, pour replonger les affamés dans une réplique nostalgique d’un diner new-yorkais. Clin d’œil direct au Red Sauce joints, ce mouvement de trattorias italo-américaines créées dès la fin du XIXe siècle par les immigrants italiens prônant une cuisine populaire et de quartier.





Face à notre salade César XXL, au poulet croustillant et parmesan abondant bordée de pasta à la vodka, nous attendons donc l’accalmie au 9, cour des Petites Écuries pour pouvoir discuter avec Guillaume Nivet, fondateur et copropriétaire du lieu. Pour le trentenaire qui a rencontré son associé Lucas Fauroux et découvert la culture “Red Sauce” lors d’un même voyage à San Francisco, l’idée pour sa cantine était “avant tout, de rendre hommage avec admiration aux univers avec lesquels nous avons grandi”.
Citant les Sopranos, le Parrain ou encore la récente série The Bear, celui qui est passé par l’école hôtelière avant d’atterrir chez Big Mamma a, sans équivoque, un faible pour la culture italo-américaine, et pour souhait principal de célébrer dans une ambiance très cinématographique “une communauté qui se regroupe autour de la nourriture ». En tombant sur l’ouvrage de Ian Mac Allen, Red Sauces : how Italian food became American, paru en 2022, force est de convenir tout de même que se réunir autour d’une table italo-américaine appartient, dans ce contexte, à plus que de la convivialité.
Sols laqués et populisme assumé
“Jon and Vinny’s a été une grande source d’inspiration pour le restaurant”, affirme Guillaume Nivet au détour d’un café, scotché à son téléphone en attendant son rendez-vous de 15h. Le directeur artistique Olivier Leone (Pragma Practice), notamment derrière l’identité de French Bastards et de Onii-San Izakaya, à Paris, a conseillé au duo le restaurant de référence qui détient près de cinq adresses entre Los Angeles et Miami, et est elle aussi “Italian inspired”. Seule différence, là-bas le Red Sauce joint n’est, contrairement à l’adresse parisienne, pas revendiqué ni associé.







« Mettre un sens social dans des références marketing est quelque chose qui revient de plus en plus dans la restauration”, note le psychosociologue, Rémy Lucas. Entre les bouillons, les PMU et les cafés de quartier, il y a dans le paysage food une envie fantasmée populaire (ou populiste ?) de se dire : « et si les classes ouvrières finissaient par avoir le vent en poupe ? Et si les élites perdaient leur place ? »… »
Cela va sans dire : c’est en partie par ce souhait de renversement du rêve américain et de la réappropriation des codes populaires par les élites que les adresses originelles, dans l’économie actuelle, ferment à tour de rôle leurs portes. L’article New York Is a Red Sauce Town. So Why Are These Restaurants Quietly Disappearing? paru dans les colonnes du Eater NYC en juillet dernier, pointe du doigt le phénomène des néo-Red Sauces fleurissant au sein de la grande pomme.
Des trattorias loin de leurs aînées ornées de photos de célébrités sur les murs, où l’on retrouve plutôt des pièces de design rares. Carbone, Cafe Spaghetti, Bad Roman… Tous détiennent des menus empreints de l’ADN populaire initial, désormais agrémentés de cocktails, vins naturels et déco léchées “plus adaptés aux attentes et habitudes de la clientèle actuelle”. Alors que l’on veuille ou non pleurer les disparitions d’adresses pionnières au profit de ces chics répliques, l’article du journaliste Joschua David Stein se clôt avec optimisme sur le “meilleur espoir des Red Sauces” que représente ces réincarnations pour la sauvegarde d’un message essentiel.
Même si, “éloigné de toute portée politique”, Guillaume ne tarit pas lorsqu’il lui est question de replacer l’origine de sa « pizza deep dish » signature – dont la création reviendrait à « un sicilien de Détroit dans les années 40, ouvrier dans l’industrie automobile, qui avait utilisé un moule profond (en fait un bac à outils) pour cuire une pizza à sa famille« . Qu’on la veuille consciente ou non, la revanche culinaire populaire est pour qui souhaiterait l’interpréter de la sorte, en un sens bien enclenchée.
À lire aussi : Nouvelle vague du restaurant chinois: quand le design s’invite à table