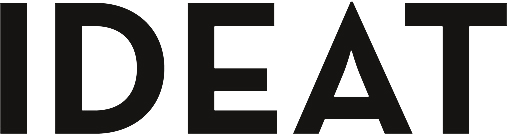« La forme d’une ville change plus vite que le cœur des humains », écrivait Baudelaire au XIXe siècle. L’exposition « Banlieues Chéries », au Musée de l’Histoire et de l’Immigration, lui donne raison en mettant en lumière les mouvements migratoires, les changements sociaux et les mutations urbanistiques qui depuis ont tous fortement impacté la mémoire collective. Une des pièces du parcours qui illustre le mieux ce propos est cette série, aujourd’hui surréaliste, de cartes postales issues de la collection Renaud Epstein (voir image ci-dessus). Datant des années 1970, elles représentent Les choux de Créteil, certes étonnants, mais aussi des barres d’immeuble de Villeurbanne, Vénissieux, Bobigny et La Courneuve, autant de spots qui hier aurait sûrement attiré les influenceurs, mais qui aujourd’hui donnent peu envie d’y adresser des « Bons baisers de… ».
À lire aussi : Portrait de ville : Tokyo, capitale montante du design
La barre d’immeuble, symbole d’une implosion sociale
Le parcours ne contourne pas les clichés. Au contraire, il les affronte pour mieux les faire voler en éclats. C’est pourquoi le S du titre a son importance. Les commissaires insistent : la banlieue est plurielle. Tout commence par un extrait du long-métrage d’Henri Verneuil, Mélodie en sous-sol, dans lequel Jean Gabin, tout juste sorti de prison après cinq ans passés derrière les barreaux, cherche sa maison dans un Sarcelles méconnaissable. De grands ensembles collectifs ont pris la place de pavillons individuels, non sans avoir eu un impact sur la manière de vivre de la population.

Ce passage du film illustre ce point de bascule qui aboutira à des banlieues dortoirs engagées à se réveiller, se situant ainsi au carrefour de l’art, de l’histoire et des dynamiques sociales. Un point de non-retour particulièrement visible et vertigineux dans le face-à-face établi entre les toiles bucoliques d’Argenteuil de Claude Monet, où le peintre s’est fait aménager un bateau-atelier en 1871, et la vidéo de Rayane Mcirdi, Le Croissant de feu (2021).
Le réalisateur y documente les regards sur l’évolution de la cité des Fleurs, située dans le quartier des Mourinoux à Asnières-sur-Seine. Construite dans les années 1960, elle a vu passer trois générations de sa famille et abritait l’emblématique barre des Gentianes, détruite en 2011. Un choc pour ses occupants, dont certains sont nés ici. Son effondrement a marqué celui d’une époque ainsi que le début d’une nouvelle ère urbanistique pour le quartier, la croissance exponentielle du coût de la vie ayant fait déménager plus loin certains habitants.
Une enclave repliée sur elle-même
Illustrant un temps fièrement des cartes postales, ces barres sont devenues le symbole de la décadence des banlieues, livrées à elles-mêmes, comme le souligne Aleteïa, artiste et commissaire : « Vivre en banlieue, ça veut aussi dire y être enclavé. Récemment, il fallait débourser 7,90 euros pour faire le trajet Corbeil-Essonnes – Paris, un tarif qui poussait les banlieusards les plus démunis à se parquer chez eux, pensant qu’on ne voulait pas d’eux à Paris ».

S’offrait alors à eux l’unique perspective de ces barres dont s’est emparé Mathieu Pernot. Il leur a consacré une large série Le Grand Ensemble, Les implosions, dévoilée dans une salle dédiée et dialoguant avec de vastes maquettes des Tours Aillaud, sublimées aussi par Laurent Kronental dans sa série Souvenir d’un futur, et capturées en 1984 par Robert Doisneau, un enfant de la banlieue.
Le photographe, comme Louis Chifflot, Robert Delhay, Monique Hervo ou Jean Pottier, a contribué à changer notre regard sur le monde populaire et la classe ouvrière, en captant la vie dans ces bidonvilles devenus villes rouges, puis lieux de luttes artistiques et politiques.
Agitation et ennui
Dans un décor de bureau de presse, l’accrochage montre comment la crise du logement et le racisme, qui n’ont cessé de croître depuis la Seconde Guerre mondiale, ont abouti aux événements de 1983. En quelques mois, plusieurs événements tragiques se succèdent : l’assassinat du touriste algérien Habib Grimzi par défenestration d’un train et les tirs sur Toumi Djaïdja, jeune président de l’association SOS Avenir Minguettes.

Dans ce contexte brûlant, la Marche pour l’égalité et contre le racisme se met en place à Marseille et à Paris. Jusqu’alors murée dans le silence, la banlieue se fait entendre et pour toujours, en chansons, en films, en peintures, et en installations, preuves à l’appui.
Mais au milieu de cette effervescence : l’ennui ! Banlieue reste bien souvent synonyme de dortoir. Il est palpable dans certaines œuvres artistiques, mais aussi dans des pièces de design comme le fauteuil Curry Mango signé Hall Haus. Le collectif de designers originaires de banlieues parisiennes et de Limoges a fusionné ici la chaise pliable de camping symbole du mobilier nomade, et le fauteuil Wassily de Marcel Breuer (1925), manifeste du design moderniste, créant un objet-pont entre deux cultures, mais aussi imageant l’ennui.
Car que faire d’autre en banlieue que de s’asseoir sur une chaise et de regarder le temps qui passe ? Semblent-ils ainsi nous dire au cœur de cette scénographie riche de diversité. Rassemblant plus de 200 documents d’archives, peintures, installations, vidéos, photographies, témoignages… l’exposition « Banlieues Chéries » explore ces territoires décriés comme des lieux de mémoire et de transmission qui continuent depuis le XIXe siècle de façonner l’histoire de France.
> Exposition « Banlieues Chéries », jusqu’au 17 août 2025 au Musée de l’histoire de l’immigration, Palais de la Porte Dorée, 293 avenue Daumesnil, Paris 12e.
À lire aussi : Jeunes designers : Hall Haus, le collectif qui secoue la scène française